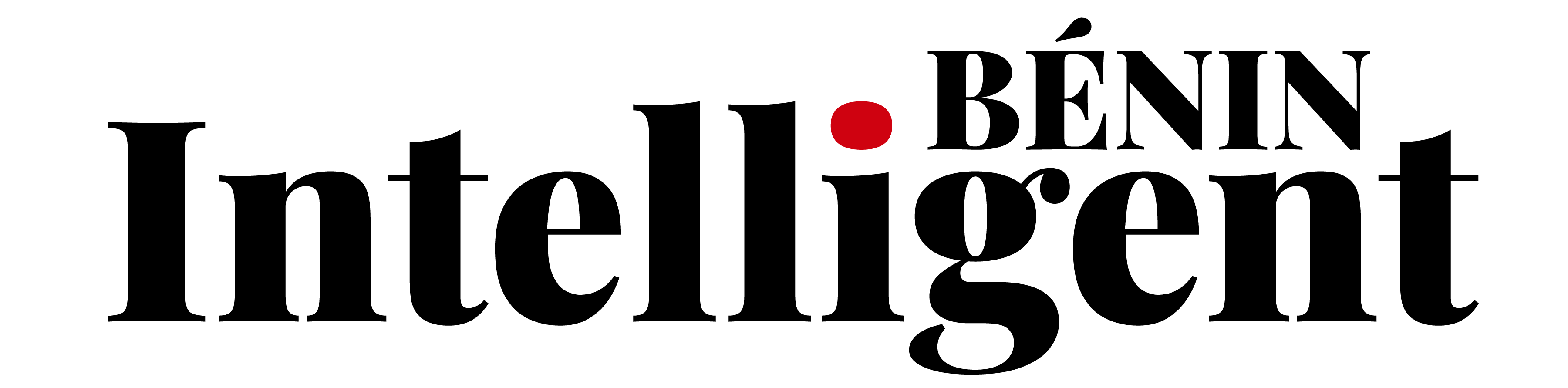“Sciences de l’Information et de la Communication”. “SIC”. “Info-Com”. Infocom”. Information et Communication. Tous ces mots et expressions désignent la même et unique réalité de l’inter discipline qui a pour objets d’étude les phénomènes en information et en communication vu sous l’angle des artefacts.
Par Gbétohou G. Wenceslas MAHOUSSI, PhD in Information & Communication.
En tentant une épistémologie des SIC, on y retrouve de la philosophie, de l’Informatique, de la psychologie, de la linguistique, de la littérature… Pour preuve, il y a une cinquantaine d’années, les pères fondateurs de la discipline dans le monde francophone venaient d’horizons divers : Robert Escarpit (Lettres), Jean Meyriat (Documentation) et Roland Barthes (Sémiologie). Nous étions en 1975 !
Les origines des pionniers ont fortement influencé les premières études dans la discipline : sémio-pragmatique, bibliométrie, étude de textes, etc. Aujourd’hui, l’émergence des technologies numériques renouvelle les approches théoriques et les études se penchent sur la manière dont les dispositifs de production, de traitement et de diffusion de l’information se positionnent dans le progrès social.
Si nous faisons partie des évangélistes qui portons un regard pluriel sur le monde de l’information et de la communication, c’est parce que les SIC regorgent d’une dizaine de sous-disciplines (cf. CPDirSIC, 2018, p.12). Il s’agit en effet de:
- 1-Médias et journalisme;
- 2-Images, cinéma, médias audiovisuels et industries culturelles;
- 3-Communication publique et politique;
- 4-Communication et organisations;
- 5-Médiations mémorielles, culturelles et patrimoniales;
- 6-Le Numérique: stratégies, dispositifs et usages;
- 7-Informations, documents et écritures;
- 8-Design;
- 9-Organisation des connaissances;
- 10-Médiation des savoirs, éducation et formation.
A titre personnel et au fil des années, nous emblavons dans plus de la moitié desdits domaines. Ayant été archiviste-documentaliste à la base, faisant et connaissant les médias et la communication et détenteur de certificats en TIC….
Regarder l’écosytème africain de l’infocom revient à analyser comment se comporte chacun des domaines pré-cités dans les trois mondes ou champs à savoir celui académique, celui professionnel et celui institutionnel.
En Afrique subsaharienne francophone, sur le plan académique et scientifique, combien d’écoles et d’instituts forment dans le champ de l’information et de la communication ? Combien d’enseignants-chercheurs et de chercheurs de rang magistral avons-nous ? Quelles sont les revues scientifiques qui paraissent régulièrement ? Quels sont les laboratoires et les unités de recherche dans le domaine ? Quels sont les évènements scientifiques à savoir les colloques, les journées d’études et autres conférences techniques ? Ceci de la part des acteurs étatiques que non étatiques.
A titre illustratif, le premier professeur titulaire en Information et Communication du Bénin prépare ses valises pour rejoindre son village natal dans quelques mois car appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C’est récemment que l’Université d’Abomey-Calavi a autorisé le deuxième laboratoire en Information et Communication.
Si la situation est peu reluisante au Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Cameroun font des efforts. Cependant les situations sont quasi-similaires au regard des effectifs des apprenants dans les filières de l’Infocom. Le Niger et la Guinée en ce qui les concernent font recours à des compétences étrangères pour combler parfois les gaps en matière de ressources humaines qualifiées dans les SIC.
Dans le monde professionnel, les réalités sont intactes. Combien d’entreprises recrutent et paient les salaires en conséquence ? Quelles sont les associations professionnelles et les réseaux de professionnels du secteur dont les voix portent ? Quels sont les standards d’exercice des métiers de l’information et de la communication dans cette partie de l’Afrique. Quand on jette un regard sur ce qui se passe dans le milieu anglophone juste à côté. Au Bénin, les professionnels de la communication n’ont pas un statut comme les journalistes alors qu’il existe un code de l’information et de la communication….
Quant au champ institutionnel, il regroupe les acteurs étatiques et trans-étatiques et les institutions de régulation qui portent les politiques publiques info-communicationnelles. Nous pouvons noter quelques avancées timides sur le continent notamment l’Afrique subsaharienne francophone. Au Bénin, le gouvernement a fait l’option de supprimer le Ministère de la Communication. Quel bilan peut-on faire de ce choix quatre ans après? Le Burkina Faso crée un Ministère de la Transition digitale. Au Sénégal, l’on pense à créer un régulateur dédié aux technologies émergentes. En côte d’Ivoire, le législateur revisite la régulation des nouveaux médias en décembre 2022.
In fine, l’écosytème de l’information et de la communication en Afrique Subsaharienne francophone donne du fil à retordre. Il revient aux différents acteurs de ce secteur de retrouver la saine synergie de leurs énergies pour un avenir prospère cette discipline 50 ans après. Escarpit, Meyriat et Barthes ont survécu !