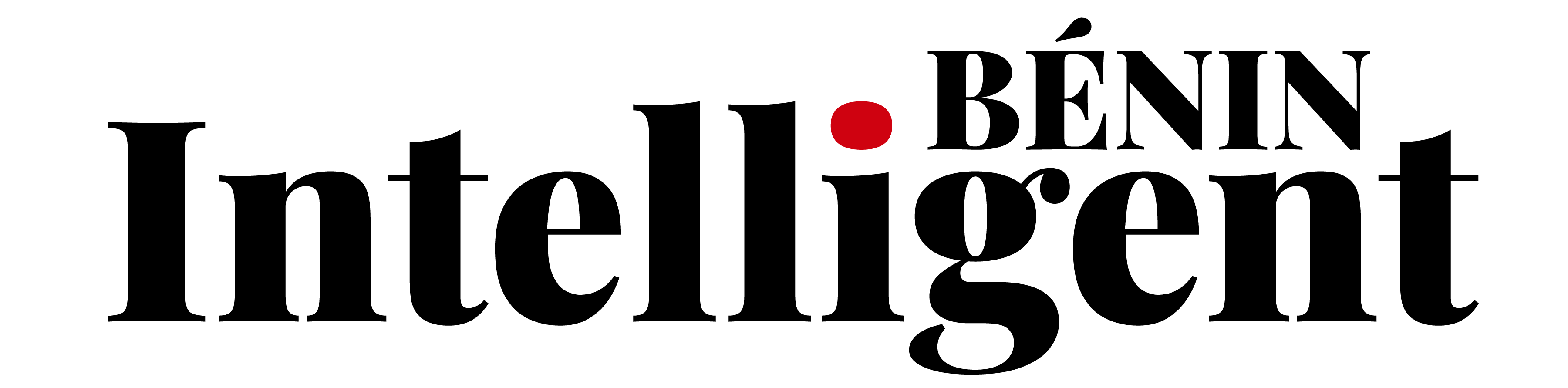La fondation Friedrich Ebert a lancé le jeudi 24 mars à l’Université d’Abomey-Calavi, le « Baromètre des médias africains », édition 2021. Le document d’une soixantaine de pages est une analyse locale de l’exercice d’évaluation du paysage médiatique en Afrique notamment au Bénin. Le rapport montre des reculs importants ces trois dernières années.
Par Raymond FALADE
Le Baromètre des médias africains présente les avancées et les reculs dans le domaine de la presse en Afrique. Pour l’édition 2021, les études ont été réalisées suivant quatre secteurs : la liberté d’expression y compris la liberté des médias, l’indépendance et la durabilité, la réglementation sur la diffusion et les médias qui appliquent des normes professionnelles élevées. Pour ce qui est du Bénin, le panel composé des experts du monde des médias et des personnes ressources de la société civile s’est réuni à Dassa-Zounmè du 27 au 29 août 2021, pour examiner et évaluer les avancées et les reculs en matière de liberté de presse ces trois dernières années.
La substance des travaux a été présentée par Dorice Djeton Goudou, journaliste experte en éducation aux médias et à l’information. La liberté d’expression, a-t-elle reconnu, est garantie par la Constitution de décembre 1990. En témoignent les articles 23 et 24 du même texte révisé en 2019. Cette liberté est également protégée par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) à travers sa loi organique ainsi que le Code de l’information et de la communication adopté en 2015. Mais les choses ne se passent pas toujours bien sur le terrain, a fait observer Dorice Djeton Goudo.
L’analyse, a-t-elle justifié, montre que ces trois dernières années, l’exercice de la liberté d’expression bien qu’effectif dans les textes n’a pas été une réalité. Les syndicalistes, les militants des droits humains, les journalistes, les dignitaires des religions endogènes et même de simple citoyen sont menacés lorsqu’il s’agit d’exercer leur droit à la liberté d’expression. « Les hommes d’affaires et entrepreneurs se sentent aussi ciblés à travers des pressions sociales, des contrôles intempestifs de leurs entreprises », a-t-elle révélé. À cela s’ajoute le Code du numérique voté en 2018 qui constitue selon le baromètre, une source de crainte pour les citoyens y compris les journalistes béninois. Le document révèle également que la détermination avec laquelle la société civile se mobilisait auparavant pour défendre la cause des médias a fortement baissé ces dernières années.
Environnement très riche mais…
Selon le baromètre, il existe au Bénin de façon légale, 72 quotidiens d’information, 8 hebdomadaires et 4 bi-hebdomadaires. Le document note plus de 90 stations de radio, une quinzaine de chaînes de télévision, des web télévisions et sites web d’information. La radio selon les statistiques, vient en tête des sources d’information des populations.
En dépit de cet environnement médiatique bien fourni, des problèmes subsistent et constituent un frein à la liberté de la presse. Le baromètre des médias africains renseigne que les médias privés béninois n’ont pas reçu de l’aide de l’État depuis plus de 5ans. « Le Code de l’information et de la communication a institué par exemple, la création d’un Fonds d’appui pour le développement des médias (Fadem) qui n’est pas encore totalement opérationnel », a déploré Dorice Djeton Goudou.
Toutefois, quelques changements ont été observés dans l’environnement des médias au cours des deux/trois dernières années selon le Baromètre. Ils concernent l’amélioration dans la formation initiale et continue des journalistes, l’augmentation du taux de pénétration de l’internet mobile, tendance vers la spécialisation des journalistes, présences renforcées des femmes dans les postes de décision des médias et l’éclosion des médias en ligne.
Pour les trois/quatre prochaines années, le Baromètre des médias africains propose entre autres, l’organisation des ateliers sur le modèle économique des médias (la publicité, la messagerie, la viabilité des médias), un atelier de relecture du Code de déontologie et l’organisation d’un colloque scientifique sur la liberté de la presse.