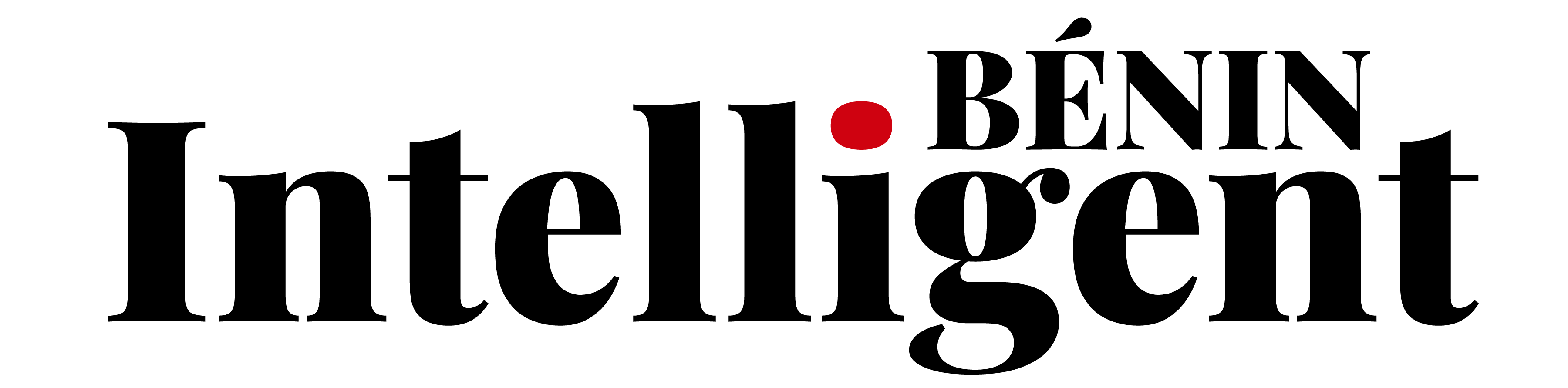Au Ghana, des centaines de femmes âgées, marginalisées et vulnérables, accusées de sorcellerie, continuent de vivre dans des conditions déplorables, sans protection ni réparation adéquates, a dénoncé Amnesty international dans un nouveau rapport publié le 14 avril dernier.
Intitulé « Marquées à vie : comment les accusations de sorcellerie entraînent des violations des droits humains de centaines de femmes dans le nord du Ghana », ce rapport met en lumière les graves manquements de l’État ghanéen à ses obligations en matière de droits humains. Plus de 500 personnes, pour la plupart des femmes de 50 à 90 ans, vivent dans quatre camps informels situés dans les régions nordiques du pays. Amnesty y a mené des recherches entre juillet 2023 et janvier 2025.
Ces femmes, souvent victimes d’exclusion sociale, sont accusées à la suite de tragédies personnelles survenues dans leur entourage. Par exemple, maladie, décès, rêves interprétés comme des signes de sorcellerie, ou refus de se soumettre à certaines normes sociales. « Mon voisin a dit qu’il avait rêvé […] que j’essayais de le tuer. Il ne veut pas de moi [dans la communauté], c’est pourquoi il m’a accusé », confie Fawza, résidente du camp de Gnani. « J’ai refusé que le chef [du village] épouse une de mes filles. Un jour, un enfant est tombé malade dans la communauté et le chef m’a accusé » explique Fatma, une autre femme du camp de Kukuo.
Ces accusations, profondément enracinées dans les croyances locales, se traduisent par des menaces, des agressions physiques, des expulsions violentes, voire des meurtres. « Les accusations de sorcellerie et les abus qui en découlent portent atteinte au droit à la vie, à la sécurité et à la non-discrimination », a déclaré Michèle Eken, chercheuse senior à Amnesty international. Selon Eken, « cette pratique profondément enracinée et répandue est à l’origine de souffrances et de violences indicibles. »
Les conditions de vie dans les camps sont particulièrement précaires relève Amnesty dans son rapport. Habitations délabrées, accès limité à l’eau potable, à la nourriture et aux soins de santé sont entre autres les difficultés évoquées. « J’ai ma propre chambre ici, mais il faut refaire le toit. L’eau traverse le toit quand il pleut » témoigne Alimata, une résidente. Une femme de 80 ans se demande quant à elle, « S’il n’y avait personne pour me nourrir, comment pourrais-je manger ? »
Une réintégration difficile
En plus de l’indifférence des autorités, aucun programme de réintégration ou d’aide économique n’est mis en œuvre. Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d’Amnesty pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale, souligne qu’ « étant donné que les résident-e-s des camps ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, les autorités ont le devoir de les protéger et de les soutenir ». Or, jusqu’à présent, « elles échouent à le faire » déplore-t-il.
Amnesty international appelle à une législation claire et contraignante pour interdire les accusations de sorcellerie et les attaques rituelles. « Les autorités doivent adopter une législation qui criminalise spécifiquement les accusations de sorcellerie et les attaques rituelles et prévoie des mesures de protection pour les victimes potentielles », affirme Genevieve Partington, directrice nationale d’Amnesty Ghana.
Mais au-delà des lois, l’organisation insiste sur la nécessité d’une approche globale. « Nous demandons instamment l’adoption d’une approche holistique qui s’attaque aux causes profondes de ces abus, notamment à travers des programmes de réintégration sociale et économique, ainsi que la protection et des réparations pour les personnes qui ont subi des abus à la suite d’accusations », poursuit Genevieve Partington.
Un projet de loi visant à criminaliser ces pratiques a été réintroduit au Parlement début 2025, après des discussions entre Amnesty et les autorités. Mais à la date de finalisation du rapport, aucune réponse officielle n’avait encore été reçue.