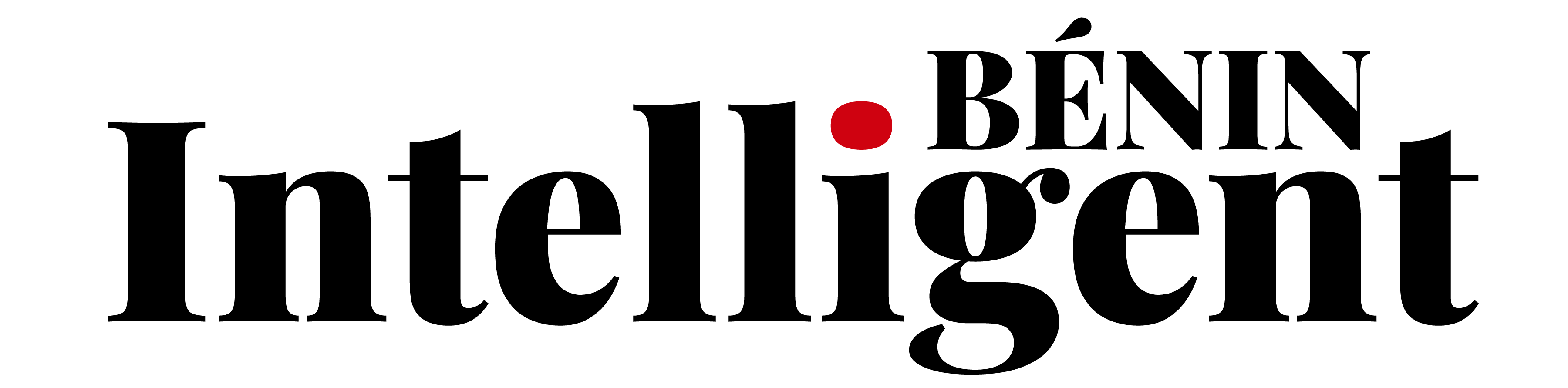Les réseaux sociaux numériques s’imposent aujourd’hui comme une alternative puissante aux médias traditionnels, notamment dans les contextes où les libertés d’expression sont restreintes. Ils permettent de contourner les filtres éditoriaux, d’atteindre directement le public, et d’optimiser la viralité d’un message – à condition, bien sûr, de disposer d’une communauté engagée et bien structurée.
Mais cette puissance ne dispense pas d’une stratégie rigoureuse, encore moins de l’expertise de professionnels en communication. Cela est davantage valable pour les «personnalité politique/publique». Preuve en est la vidéo de Richard Boni Ouorou qui devrait profondément interpellé tout utilisateur des réseaux sociaux numériques : on l’y voit, assis à l’air libre, partageant un plat de ”azingokwin” avec trois œufs. Dans les commentaires, certains followers chantaient son ”humilité”. Humilité ? A l’opposé, je m’étais, moi, inquiété de sa ”chute socio-numérique”.
Certes l’intention derrière son geste est noble : projeter l’image d’un homme simple, enraciné, partageant le quotidien des couches populaires. Mais l’effet produit fut tout autre. L’algorithme, impitoyable, a déformé le message initial. Justement beaucoup d’internautes l’ont perçu comme une mise en scène maladroite, voire condescendante. Car en réalité, combien de Béninois – parmi ceux que le politologue Richard Boni Ouorou pensait toucher, rallier – mangent (encore) ce plat, et pire avec trois œufs ? Autrement, cette image, au lieu de gommer la distance sociale, l’a exacerbée. Pour certains, Richard Boni Ouorou ne partageait pas la précarité : il la mimait. D’aucuns y ont vu une forme d’ironie sociale, presque une moquerie.
Ce cas illustre avec force que la communication digitale, surtout en politique, ne s’improvise pas. Il ne suffit pas d’être sincère ou populaire. La sympathie ou la réputation ne se gagne pas à ce prix. Sur le digital, il faut maîtriser les codes, comprendre les perceptions sociales, et anticiper les interprétations. À défaut, on s’expose à des malentendus lourds de conséquences.
À l’ère des réseaux sociaux, l’accompagnement par des spécialistes en image et communication est indispensable – notamment pour celles et ceux qui aspirent au statut de personnalité publique. Sans cela, l’e-réputation peut rapidement tourner au fiasco, parfois de manière irréversible.
Exposition de soi
L’e-réputation désigne la perception, l’image que les internautes ont d’un produit, d’une marque ou d’une personne. Ce que Erving Goffman (1973) et d’autres (Granjon et Denouël, 2010) appellent «exposition de soi» ou « mise en visibilité de soi sur Internet.» Cette perception n’est pas une génération spontanée. Elle émane d’abord de «ce que» je projette dans le public. D’où le sens exhaustif qu’en donne Amessinou (2025), à savoir que :
«L’e-réputation se définit comme l’image véhiculée ou subie sur le web d’une entreprise, d’une marque, d’un particulier ou d’un produit, que ce soit sur les moteurs de recherche, les plateformes d’avis, les réseaux sociaux, le bouche à oreille numérique, etc.»
Elle est donc «souvent impacté positivement ou négativement par des articles de presse, des avis clients, des messages sur les forums, des photographies, l’activité sur les réseaux sociaux, etc.». L’enjeu réside donc dans la crédibilité et la visibilité.
Sur les réseaux sociaux numériques, «Je ne communique pas pour le plaisir de communiquer. Ce que je produis aujourd’hui peut me revenir demain, en bien ou en mal. » C’est un principe de base que toute personnalité publique devrait graver dans sa stratégie de communication.
Je doute fort que le geste de Richard Boni Ouorou – sortir de chez lui, choisir une tenue, se rendre à Cadjehoun, acheter un plat de ”azingokwin” coiffé de trois œufs, et immortaliser la scène en vidéo – ait été le fruit d’une réflexion collective, validée par une équipe de communication. Tout porte à croire qu’il s’agissait d’un acte impulsif, sans filtre, sans stratégie. Une « spontanéité numérique » aux conséquences symboliques ravageuses.
Selon les données de l’ARCEP, plus de huit millions de Béninois sont connectés à Internet. Cela signifie qu’un Béninois sur deux est potentiellement un créateur de contenu — souvent sans en avoir conscience. Les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans les usages quotidiens, mais paradoxalement, aucun programme national structuré d’Éducation aux médias et à l’information (EMI) n’a encore été mis en œuvre. Ni dans le système éducatif, ni à grande échelle dans l’espace public.
Résultat : pour beaucoup, posséder un smartphone Android et une connexion internet suffit à se proclamer “communicant”, “influenceur”, ou “acteur numérique”, sans jamais interroger les implications sociales, politiques, psychologiques ou juridiques de cette exposition. Des scènes profondément intimes se retrouvent ainsi projetées dans l’espace public numérique, sans possibilité de retour, de rectification.
Or, tous les professionnels le savent : on ne publie pas par plaisir. Si vous ressentez du plaisir à exposer votre vie privée, ce plaisir doit être corrélé à un objectif digital précis. Une photo de votre couple, de vos enfants, de vos vacances, de vos moments d’intimité peut tout à fait rester dans votre téléphone, comme souvenir personnel. Mais dès que l’envie de « balancer ça sur la toile » vous traverse, la seule vraie question à se poser est : dans quel but ?
Cas d’alerte
Revenons à Richard Boni Ouorou. Il a commis, à mon sens, deux erreurs majeures en communication numérique. La première est politique. L’homme semblait vouloir se positionner comme une figure montante sur l’échiquier national. Mais son flou stratégique était criant : était-il de la mouvance ? Non, à en croire ses prises de parole. Était-il de l’opposition ? Les Béninois le supposaient. Mais voilà qu’en l’espace de quelques vidéos, il s’en prend indistinctement à tous les leaders de l’opposition. Résultat : confusion totale. Perte de repères et chute de crédibilité.
La seconde erreur relève d’un manque d’objectif clair en communication digitale. Que cherchait-il ? À construire une notoriété ? À fédérer une base électorale ? À renforcer son image publique ? À créer de l’engagement autour de ses idées ? Aucun message n’était suffisamment lisible ou structuré pour répondre à ces interrogations.
En cette veille d’élections générales en 2026, ce cas doit servir d’alerte. Les acteurs politiques – qu’ils soient candidats, militants ou partis – doivent impérativement se doter d’une stratégie digitale cohérente. Cela suppose des objectifs précis, une connaissance de leur audience, une charte éditoriale, une validation rigoureuse des contenus avant diffusion, et le choix des plateformes les plus pertinentes selon les cibles.
Car dans l’arène numérique, l’erreur de posture peut être fatale. Et la toile, elle, n’oublie jamais.