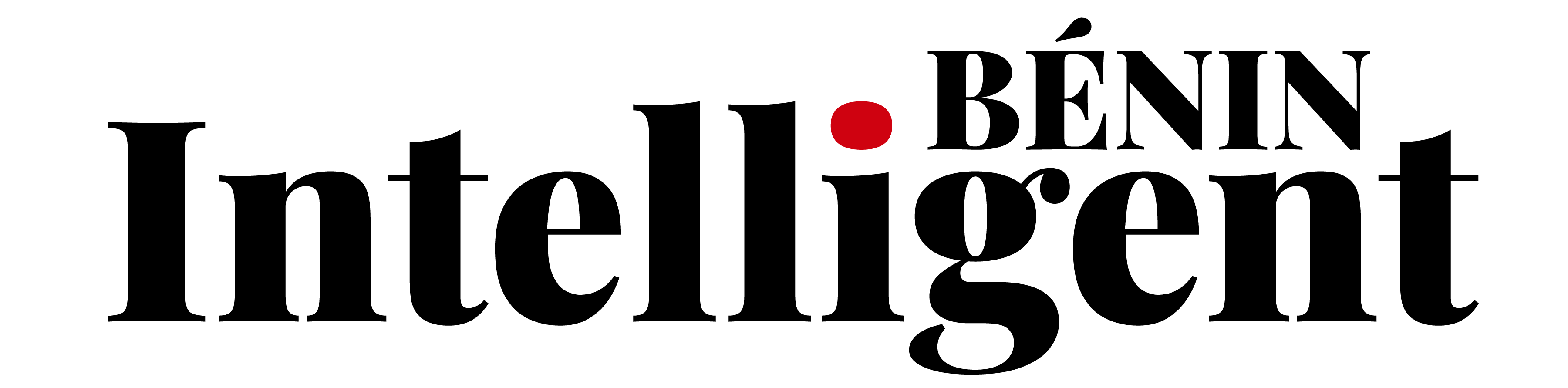Le groupe Lakurawa constitue une menace pour la stabilité sous-régionale. C’est du moins ce qu’observe Sani Saidu Muhammad, journaliste nigérian spécialisé dans les économies illicites et les questions humanitaires. Selon lui, la réémergence de Lakurawa en tant que groupe terroriste islamiste résulte des facteurs comme la mauvaise gouvernance et de manque du contrôle des groupes d’autodéfense.
Bénin Intelligent : Quelle appréciation faites-vous de la coopération entre le Bénin et le Nigéria dans la lutte contre l’extrémisme violent et le banditisme frontalier ?
Sani Saidu Muhammad : Le Bénin et le Nigéria ont sans aucun doute pris des mesures pour lutter contre l’extrémisme violent et le banditisme aux frontières. Surtout par le biais d’initiatives conjointes menées sous l’égide de la Cedeao et de la Force multinationale mixte (Fmm). Toutefois, l’efficacité de ces collaborations reste à prouver. Puisqu’elle est souvent insuffisante en raison d’une mise en œuvre incohérente et de ressources limitées. Par exemple, si les patrouilles conjointes et le partage de renseignements sont louables, rien ne prouve qu’ils aient permis de réduire de manière significative les incidents de violence transfrontalière ou de contrebande entre les deux frontières. Pour réaliser de véritables progrès, les deux pays devront donner la priorité à la construction d’infrastructures frontalières, harmoniser leurs cadres juridiques et instaurer la confiance, non seulement entre les gouvernements. Mais aussi avec les communautés frontalières dont la coopération est essentielle à la sécurité à long terme.
Si l’objectif des Lakurawa n’est pas la conquête immédiate d’un territoire, quel est leur véritable objectif ?
Le groupe Lakurawa poursuit un objectif stratégique. En effet, il ambitionne de déstabiliser les structures étatiques pour créer des espaces sans gouvernance où ses activités, allant de l’endoctrinement aux entreprises criminelles, peuvent prospérer. D’ailleurs, il prospère en exploitant les griefs socio-économiques tels que la marginalisation, la pauvreté et la mauvaise gouvernance. En créant le chaos, il sape la confiance du public dans l’État, transformant la peur et la frustration en opportunités de recrutement et d’influence. Ses objectifs sont idéologiques, certes, mais aussi profondément pragmatiques : il cherche à contrôler les ressources, les lieux stratégiques et les populations vulnérables.
Pensez-vous que la réémergence des Lakurawa en tant que groupe terroriste islamiste dans le nord-ouest du Nigeria affaiblira davantage la sécurité transfrontalière des pays d’Afrique de l’Ouest à long terme ?
La réemergence du groupe Lakurawa représente une menace sérieuse pour la sécurité régionale. Leurs activités exacerbent les vulnérabilités dans la gestion des frontières, offrant un terrain fertile à la contrebande d’armes, à la propagation d’idéologies extrémistes et à la déstabilisation des États voisins. Les communautés des zones touchées font souvent état de craintes accrues de violences, de perturbations des économies locales et d’une confiance affaiblie dans les appareils de sécurité des États. À long terme, la présence des Lakurawas pourrait mettre à rude épreuve les alliances régionales comme la Cedeao, car les pays donneraient la priorité aux crises nationales plutôt qu’aux efforts de sécurité concertés. Sans action décisive, ces menaces risquent de dégénérer en une instabilité régionale plus large.
Avec la réapparition du groupe Lakurawa, faut-il craindre la djihadisation des groupes d’autodéfense dans l’ouest du Nigeria, à la frontière avec le Bénin ?
Les groupes d’autodéfense émergent comme des réponses populaires à l’insécurité. Mais leur manque de régulation les rend vulnérables à la cooptation par des éléments djihadistes. Si les influences de Lakurawa s’infiltrent dans ces groupes, ils pourraient se radicaliser et évoluer vers des réseaux extrémistes sous couvert de protection communautaire. Des données issues de contextes similaires, comme dans certaines régions du Sahel, montrent comment ces groupes, lorsqu’ils ne sont pas contrôlés, peuvent brouiller les lignes entre les groupes d’autodéfense et les terroristes. Des mesures proactives, notamment des mécanismes de surveillance, une intégration formelle dans les cadres de police de proximité et des campagnes d’éducation ciblées, sont essentielles pour atténuer ce risque.
Quels sont les principaux défis à relever au niveau régional pour éviter la “djihadisation du banditisme” ou la “djihadisation des groupes d’autodéfense” ?
Pour prévenir la djihadisation du banditisme et des groupes d’autodéfense, plusieurs défis régionaux doivent être relevés. Comme le renforcement des contrôles au niveau des frontières par exemple. Ceci grâce à la technologie et à l’engagement communautaire. Aussi, les États doivent rétablir une proximité avec les gouvernés en améliorant leur gestion de la chose publique, en particulier dans les communautés marginalisées. De même, la Cedeao et ses États membres doivent harmoniser leurs efforts.
De plus, les groupes d’autodéfense doivent être surveillés. Formés et intégrés aux structures de sécurité officielles. Ceci a pour but d’éviter toute dérive. La réussite de cette lutte dépend d’une approche régionale fondée à la fois sur la volonté politique et sur l’inclusion communautaire. Les Lakurawas prospèrent là où les gens se sentent abandonnés. Il faudra alors veiller à ce qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte. C’est là la meilleure défense contre leur propagation.
Entretien réalisé en anglais. Traduit en français par Deepl