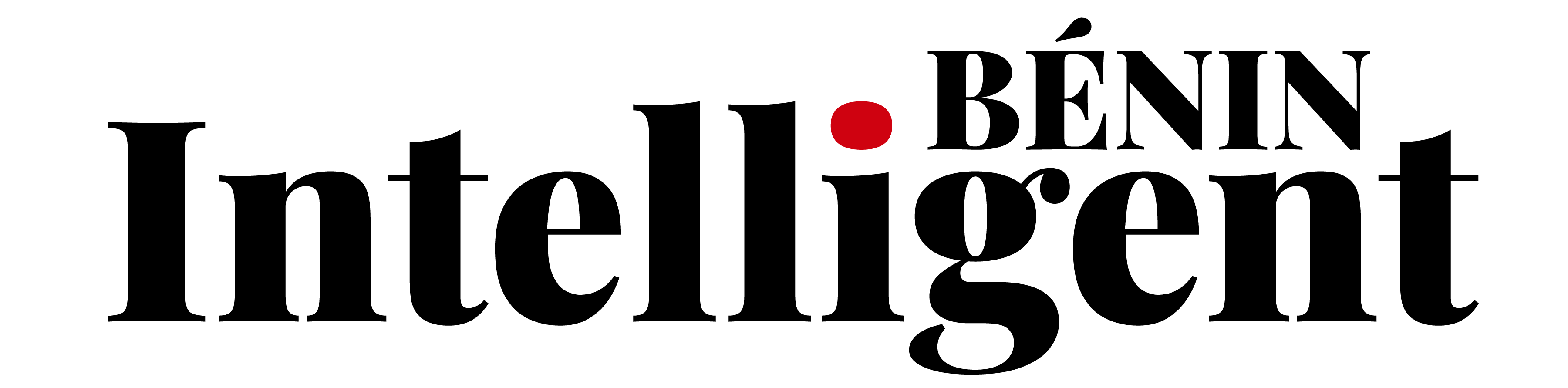Ne pas poursuivre la grossesse : c’est souvent le choix qui s’offre généralement aux survivantes de viol. La loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin en 2003, modifiée en décembre 2021, leur garantit ce droit. Mais dans quelles conditions ces survivantes sont-elles prises en charge dans notre pays ? Comment les prestataires de services parviennent-ils à les accompagner ? Reportage à Abomey-Calavi.
La dure réalité !
Adèle, 19 ans, vient de quitter une clinique située à Abomey-Calavi, une commune voisine de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La tête baissée, permettant à peine de discerner sa mine serrée, elle se hâte de monter dans un véhicule qui l’attendait, rejetant notre sollicitation.
Adèle venait d’un centre de santé privé agréé pour offrir les services d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) sécurisée. Une semaine plus tôt, la jeune fille avait été victime d’un viol, entraînant une grossesse non désirée. Après plusieurs jours d’hésitation, elle a décidé de ne pas poursuivre cette grossesse. Elle était donc venue entamer le processus nécessaire, raconte, sous anonymat, une source à l’hôpital.
En réalité, Adèle fait partie des 5 à 10% des femmes reçues dans cette clinique parmi toutes celles qui sollicitent des services d’IVG sécurisée, explique la sage-femme responsable de cette clinique. « Les survivantes de viol que nous recevons, veulent juste qu’on leur donne le service sans qu’elles n’exposent ce qu’elles ont vécu, parce qu’elles estiment subir le regard des autres sur elles », poursuit-elle.
Or, la recherche de précisions permet, en effet de remplir un formulaire devant servir à la poursuite des auteurs, ajoute l’agent de santé. « Mais elles [les victimes] vous disent ne pas en avoir besoin. Et c’est ce qui explique le fait qu’on a beaucoup de victimes de viol mais on n’a pas beaucoup de personnes qui se plaignent pour avoir gain de cause », regrette la responsable de clinique rencontrée à Abomey-Calavi.
Là où tout commence
Bien que les survivantes de viol refusent, pour la plupart, de se confier à l’hôpital concernant les circonstances de l’agression, elles le font généralement auprès des guichets uniques de protection sociale, anciennement appelés « Centres de protection sociale (CPS) ». Les informations sont cruciales pour que le dispositif de prise en charge se mette en branle, avant même les étapes de l’hôpital et de la justice.
Edwige Guèdègbé, cheffe guichet unique de protection sociale (GUPS) d’Abomey-Calavi raconte :
« Soit les parents viennent directement dans notre structure avec les victimes, soit celles-ci sont orientées vers le centre pour solliciter d’aide. Il est urgent d’agir rapidement, selon la situation. Nous recevons les survivantes en consultation sociale, les mettons en confiance pour un entretien approfondi. Nous orientons ces victimes d’agressions sexuelles vers le commissaire de leur zone de résidence pour l’obtention de la réquisition au nom du directeur de l’hôpital. Ce document couvre les dépenses liées aux soins (examen gynécologique, prescription des traitements, orientation vers les services adaptés de PEC psychologique et psychosocial) et facilite, par ailleurs, la délivrance du certificat médical, une pièce essentielle à ajouter au procès-verbal. Ensuite, s’enclenche une démarche parallèle pour rechercher le ou les auteurs de l’acte afin de démarrer la procédure judiciaire ».
Il s’agit donc d’un mécanisme bien rodé permettant aux victimes de viol de bénéficier d’une prise en charge, conformément à la loi. En 2024, le guichet unique de protection sociale d’Abomey-Calavi a recensé 16 cas d’agression sexuelle, dont 2 se sont soldés par des grossesses non désirées. Dans ces cas, le consentement de la survivante compte beaucoup pour les soins liés à l’IVG sécurisée, souligne la responsable du GUPS. « Si les conditions sont réunies, nous, assistants sociaux, donnons un avis pour ces soins », ajoute Edwige Guèdègbé.
Dans la plupart des cas, ce sont les parents qui accompagnent les personnes survivantes d’abus sexuel au centre. Ils sont habilités à le faire au terme de la loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin.
Toutefois, les survivantes de viols peuvent se rendre, seules, dans les établissements de santé. Mais, souligne la sage-femme au moment de notre passage à l’hôpital, « si c’est juste après le viol, il y a des centres exclusivement agréés pour les recevoir. Mais si c’est des jours après le viol qu’elles remarquent un arrêt et viennent demander le service, tous les centres dédiés peuvent les recevoir ».
En tout état de cause, ajoute l’agent de santé, les survivantes doivent permettre à l’agent qui les reçoit d’enclencher le processus de dénonciation pour que l’officier de justice démarre l’enquête. Toutefois, les mineures survivantes de viol doivent impérativement être accompagnées par un parent ou un tuteur légal pour pouvoir bénéficier du service. Si le parent auteur du viol accompagne l’enfant, l’agent de santé devra contacter un autre parent de la mineure, avec son consentement. Dans ce cas, le volet judiciaire doit être immédiatement engagé, précise la sage-femme interrogée.
Que disent les textes ?
Nous avons posé la question à la juriste Maryline Sourou. Elle précise que l’accès aux services d’IVG sécurisée pour les survivantes de viol était déjà prévu par la loi de 2003, notamment lorsqu’une grossesse résulte de cette relation abusive. La loi modificative et complétive 2021-12 du 20 décembre 2021 sur les DSSR, a également ramené cette condition en son article 17-1 :
« L’IVG est autorisée sur prescription d’un médecin lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte, elle-même ou par ses représentants légaux, s’il s’agit d’une mineure ».
Les « représentants légaux », explique la juriste, renvoient aux personnes reconnues devant la loi comme ayant ou exerçant l’autorité parentale sur la victime en question (exemple : parents, oncles et tantes ou toute autre personne). Il en est de même pour une personne majeure qui n’a pas toutes ses facultés mentales.
En clair, la femme victime de viol peut, si elle le souhaite, demander une IVG sécurisée dans une formation sanitaire reconnue par la loi. Il s’agit des centres de santé publique et des centres de santé privés qui ont l’agrément du ministère de la Santé. À ce niveau, « il n’y a pas de limites pour le nombre de mois de gestation, pas de limite en fait pour le nombre de semaines d’aménorrhée », souligne Maryline Sourou.
Le poids de l’objection de conscience
Les professionnels de la santé doivent déclarer leur objection de conscience à la prestation de services IVG lors de leur entrée en fonction, conformément au décret d’avril 2023 pris en application de la loi DSSR de 2021. « C’est-à-dire que je dois déclarer que je ne suis pas en accord ou mes valeurs ne sont pas en accord avec l’offre de service d’IVG », d’après la juriste Maryline Sourou.
Si un professionnel de santé ou une professionnelle de santé ne le fait pas, il ou elle n’a pas le droit de refuser l’offre de service d’IVG à une femme ayant exprimé le besoin. Toutefois, poursuit Mme Sourou,
« dans le cas où j’ai signé en tant que professionnel de santé, la fiche d’objection de conscience, et je reçois une personne majeure qui remplit les conditions fixées par la loi, et qui est une survivante de viol, ou ses représentants légaux, selon le cas, je dois l’orienter vers un autre professionnel de santé qui va pouvoir lui offrir le service. Cet autre professionnel de santé n’a pas signé sa fiche d’objection de conscience et donc ne dira pas qu’il ne va pas offrir le service ».
À la spécialiste du droit de conclure que, tout agent de santé qui ne procéderait pas ainsi, s’oppose aux dispositions légales en vigueur et s’expose, dès lors aux différentes sanctions prévues par le Code pénal.
Des résultats probants
L’accessibilité des services d’IVG sécurisée aux survivantes de viol et plus largement aux femmes dans le besoin, induit une régression de la courbe des décès en Afrique. Au Bénin, elle était de 220 décès pour 100.000 avortements à risque. Le guichet unique de protection sociale d’Abomey-Calavi s’emploie même à la prévention des cas de viol. Et les résultats à propos sont déjà perceptibles, assure la cheffe Edwige Guèdègbé. À titre illustratif, en 2022, 41 cas de viol ont été enregistrés dans ce guichet, 31 en 2023, et 16 seulement en 2024 (ndlr).
Les équipes d’Edwige Guèdègbé comptent non seulement sur la sensibilisation et la formation des groupes organisés d’artisans, de femmes, de leaders religieux, de chef de collectivités mais aussi sur l’appui constant du mouvement ‘’Les hommes s’engagent’’.
Co écrit par
Fleur Olive OUSSOUGOE
Christian GANDJO
Flore NOBIME