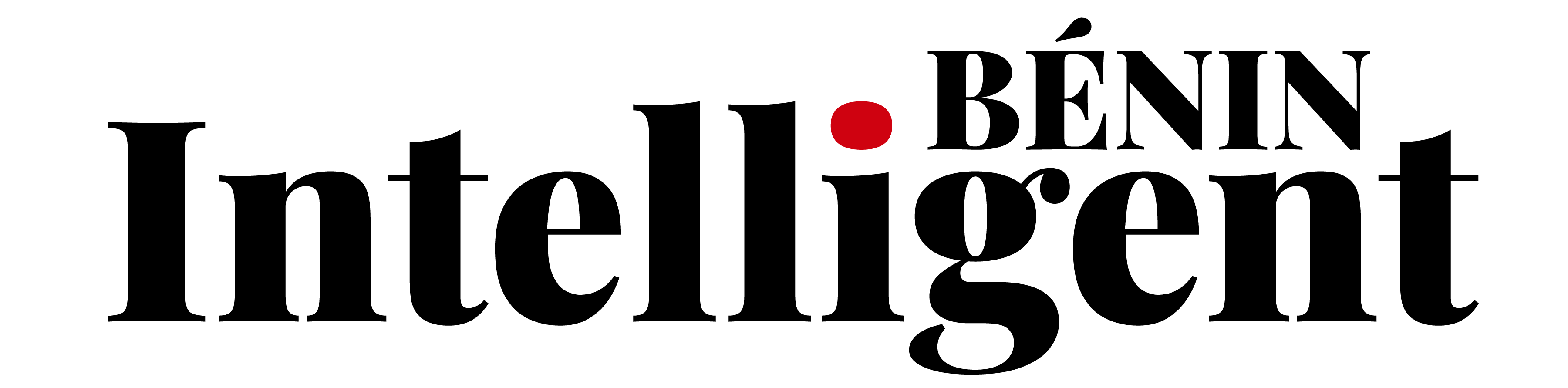Le JNIM intensifie ses actions au nord du Bénin et du Togo. Bien qu’aucun territoire ne soit officiellement revendiqué, son influence létale se renforce. Quels mécanismes sous-tendent cette avancée stratégique vers les pays côtiers ? Le professeur titulaire de sociologie à l’Université Yambo Ouologuem de Bamako, Bréma Ely Dicko, fin connaisseur de la Katiba Macina, décortique à travers cet entretien les dynamiques clés de l’expansion du Jnim.
Bénin intelligent : Peut-on y voir une inflexion idéologique significative entre le Jnim et le Fla au vu des rapprochements qui ont eu lieu entre les deux groupes ces dernières semaines ?
Dr Bréma Ely Dicko : Disons oui, en partie. D’abord, le Jnim étant dirigé par Iyad Ag Ghaly qui est originaire de la région de Kidal. Objectivement donc, il est touareg comme les membres du Front de libération de l’Azawad qu’on appelle Fla. De plus, il y avait déjà une sorte de pacte de non-agression entre les deux entités. Il n’existe pas de document écrit à cet effet. Toutefois, les deux ont les mêmes sphères d’intervention. Ils ne s’attaquent pas. C’est un fait. Le seul problème, c’est que le Front de libération de l’Azawad voulait au début l’indépendance de l’Azawad. Cela n’est pas accepté par tous. C’est pareil avec les pays du monde entier. De fait, des accords de paix ont été signés.
Cependant, le groupe (Fla) a continué à garder les armes. Malgré le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion (DDR) qui avait été mis en place depuis 2015 dans le cadre de l’accord issu du processus d’Alger. Ensuite, entre-temps, il y a eu des frictions entre le Mali et ses partenaires. Ce qui a induit par exemple, la fin des différentes opérations militaires étrangères sur le territoire malien. Puis, la reconquête de Kidal qui est le bastion de la rébellion Touareg donc du Fla. Finalement, le Fla étend acculer, beaucoup de membres se sont retranchés à Tinzawaten du côté d’Alger. Dans cette dynamique, pour reprendre le poil de la bête, ils ont jugé nécessaire de collaborer avec le Jnim.
Parce que le Jnim est aussi acculé par les autorités maliennes qui travaillent de concert avec le Burkina et le Niger maintenant dans les opérations antiterroristes. Ceci avec l’usage des moyens aériens.
Dans les discussions ou de ce qu’on apprend, le Jnim revoit son modus operandi. Ne touche plus aux communautés et ne tient pas forcément à l’application stricte de la charia. Dorénavant, il accepte plutôt qu’on se focalise sur les “Cadis“. Les ‘‘Cadis’’ sont des juges musulmans qui utilisent le coran pour trancher les différends. De même, il semblerait que les leaders du Fla aussi ne sont pas contre cela. D’autant plus que les ‘‘quadis’’ ont toujours existé dans la zone. Avant même l’avènement du terrorisme au Mali. Deux intérêts renforcent les argumentaires avancés. Nous avons entre autres un intérêt de pouvoir se renforcer mutuellement, militairement pour pouvoir agir. De deux, il y a une sorte d’inflexion comme on peut le penser. Puisque le fait de renoncer à l’application stricte de la charia permet une collaboration avec le groupe Fla qui est une organisation politique.
Pensez-vous que le Jnim pourrait se distancier du Al-Qaïda comme ça a été le cas avec le HTS ?
Ces groupes évoluent à l’heure et se recomposent au gré des opportunités et des contraintes de terrain. Les communautés ne connaissent pas al-Qaïda. Par contre, les communautés identifient et connaissent les leaders de ces groupes qui sont nés dans leur milieu. Les gens, les ont côtoyés avant même qu’ils ne soient dans ces groupes terroristes. C’est alors beaucoup plus simple, pour se faire accepter par les communautés locales, de renoncer à un groupe qui est al-Qaïda. Qui est trop lointain et dont les origines sont aussi lointaines. Pour faire simple, c’est tout à fait une possibilité. D’autant plus qu’à part, peut-être les moyens logistiques qu’al-Qaïda pourraient mettre à la disposition du Jnim, il n’y a pas autre avantage en tant que tel.
Le Jnim poursuit-t-il une stratégie d’expansion territoriale durable vers les États côtiers ?
L’extension de Jnim vers les pays côtiers est tout à fait logique. Pour moi, c’est une stratégie d’expansion très claire, dans la logique d’avoir une zone de grande sphère d’influence. Qui certainement permet de maximiser en termes de zones d’action et de ressources financières. On sait par exemple que les armes viennent des pays côtiers. Il en va de même en ce qui concerne les produits psychotropes. Tous les trafics sont habituels dans ces pays côtiers et passent ou traversent le Sahel pour l’Europe.
On sait également que ces trafiquants sont acculés par les autorités des pays côtiers qui luttent contre la criminalité organisée en partenariat avec les pays du Sahel. Bon, l’ennemi de ton ennemi étant ton ami finalement, le Jnim et certains groupes peuvent collaborer facilement. Comme ça, chacun trouve son compte. Cela permet entre autres au Jnim d’avoir de nouveaux adeptes. Mais aussi des ressources financières, des moyens matériels pour mener ses activités convenablement. D’ailleurs, on sait que dans les zones du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire, il y a aussi les mêmes terreaux favorables qui ont permis l’enracinement des groupes terroristes dans le Sahel.
Certains observateurs évoquent la volonté du JNIM d’établir un corridor transfrontalier, allant du nord du Mali jusqu’aux côtes du Golfe de Guinée. Qu’en pensez-vous ?
Ce n’est plus une hypothèse. C’est ce qui se passe. Lorsque Kadhafi est tombé en 2011, il y avait un couloir dans le désert qui quittait la Libye et qui faisait transiter les armes vers le Sahel. Maintenant, la Libye, même a utilisé ces armes dans le cadre de la compétition entre les différents camps libyens. Il en est de même entre les régimes soutenus par la communauté internationale. Il faut alors trouver d’autres alternatives. Donc, aller vers les pays côtiers aujourd’hui est une réalité depuis quelques années. Cela permet d’avoir d’autres canaux de trafic d’armes et de ressources.
Le JNIM s’appuie sur une constellation de sous-groupes et de katibas à géométrie variable. Lequel de ses acteurs vous semble le plus influent – et potentiellement le plus menaçant – pour la stabilité des pays côtiers ?
Lorsque le Jnim intervient par exemple pour le moment au Togo et au Bénin et en Côte d’Ivoire, c’est en tant qu’entité. Il est clair que si on prenait l’exemple du Mali, ça va être la Katiba Macina, côté centre du Mali. Quand on est dans les régions du Nord, c’est plutôt Ansar dine qui est dirigé par Iyad Ag Ghaly lui-même. Mais, du côté du Burkina, c’est Ansaru Sunna. A mon avis, et pour le moment, c’est l’entité qui intervient. Petit à petit, le leadership devient toujours local. Au début ou pour le moment, c’est des étrangers donc des Maliens et des Burkinabés qui gèrent les branches affiliées au Jnim. Lorsque le Jnim s’implante véritablement au Bénin et au Togo, ça va être des jeunes, des Togolais et des Béninois qui vont être identifiés.
Pour ensuite former des ‘Maqsad’ et plus ça s’étend dans le pays, plus ils vont former des unités combattantes. Dans ces unités combattantes, en général c’est 10 à 12 personnes. Soit un commandant militaire et puis quelqu’un qui est un guide spirituel qui forment les gens. Pour le moment, ce sont des étrangers, des Maliens et des burkinabés et des nigériens qui dirigent mais avec le temps, ils vont identifier tous les frustrés. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait un leadership togolais et béninois qui émerge en fonction de la capacité d’enracinement de ces groupes.
Comment analysez-vous l’intensification des attaques ciblées contre les forces armées, tant dans le sud du Sahel que dans le nord des États côtiers ?
Ces groupes, au début, vont toujours dire aux populations vous savez nous on n’a aucun problème avec vous. Notre ennemi, c’est l’armée. Au Mali, c’était le même modus operandi. Petit à petit, ils ont commencé à s’attaquer à des leaders et des élites locales qui ne sont pas d’accord avec leur élite religieuse ou politique. Plus tard, il y aura des EEI qu’ils mettront sur les routes pour faire beaucoup de victimes. Après, ils vont imposer la zakat, un style vestimentaire, la barbe qu’il faut laisser, les boubous, etc. C’est vraiment le modus operandi classique. Ils commencent doucement. Pareil avec ce qu’ils font au Bénin et au Togo maintenant.
La deuxième étape sera de trouver des leaders locaux qui vont répandre le message et élargir la base. De fait, ils vont obliger les communautés de sorte à avoir des accords de reddition. C’est des pactes où vous ne donnez pas les informations sur les positions des groupes. Vous ne dites pas où ils habitent, ou comment ils font.
Face à l’usage croissant de drones et d’armes modernes par les jihadistes, les États régionaux doivent-ils repenser leur propre recours à ces technologies ?
Au Mali, il y a au moins 3 à 4 camps sur lesquels des drones ont été lancés. Au Togo aussi ils en ont fait usage. Il y a des drones de tous types et avec des autonomies variées qui ne coûtent pas forcément cher. Il y en a pour toutes les bourses. Ils arrivent à modifier ça avec des canettes de boissons. Ce sont des drones kamikazes. Ils utilisent aussi des drones de surveillance. Parce que les drones qu’on a peut filmer. Même si vous les détruisez, une fois connecté à un téléphone ou à un truc, vous pouvez voir les images. Ça peut permettre de surveiller les routes utilisées pour les patrouilles.
De plus, ils permettent de voir la disposition des camps. A mon avis, ces analyses doivent pousser les autorités des différents pays à voir avec quel système empêcher les drones. Avant même qu’ils atteignent les camps et les guérites.
La question des couveuses locales, on en parle ?
Ces couveuses sont déjà là. Elles ont déjà commencé à éclore. Il y a forcément des cellules dormantes. Puisque souvent, vous savez, ils activent et forment des gens. Qui par la suite deviennent des commerçants ou qui s’investissent dans d’autres activités. En vérité, ces couveuses ont déjà fait des éclosions. Puis, il y a d’autres couveuses qui continuent d’éclore. Pour lutter contre cela, toutes les stratégies menées sont déjà bien. Mais, en même temps, il faut renforcer les renseignements humains et travailler à répondre aux aspirations des populations locales. Avec pour objectif, de réduire les terreaux favorables. Les jeunes qui n’ont pas d’emploi, il faut les occuper avec les formations professionnelles. Avec l’entrepreneuriat, des prêts etc.
Il faudrait également revoir les affaires en justice pour les diligenter. Que les représentants de l’Etat changent aussi de comportement. Plus de racket de ponction. Qu’on arrête cela parce que tout cela était un moyen de frustrer les populations. C’est en revoyant la gouvernance, en essayant d’avoir des États plus utiles et non des Etats qui font de la ponction de racket qu’on arrivera à voir de nos côtés les populations. Aussi, dans les opérations antiterroristes, c’est aussi faire attention à ne pas faire des arrestations arbitraires. Qu’on le veuille ou pas c’est vrai que lorsque les armes crépitent, les droits de l’Homme sommeillent.
Toutefois, il faut veiller à ce que nos propres armées ou nos opérations ne soient pas des opérations qui oppressent. Il faudra de même qu’on travaille à renforcer les compétences des autorités territoriales. Qu’on valorise nos propres mécanismes endogènes pour pouvoir, je pense juguler les conflits qu’on a entre-nous. Afin d’éviter que ces conflits aillent au niveau de la justice. A mon avis, tout ceci permettra d’instaurer un climat de paix et de sérénité.
Pour mieux combattre les discours extrémistes que faire selon-vous ?
Il faut mobiliser un contre discours religieux en associant les oulémas. Autrement dit, les érudits musulmans qui connaissent le Coran. Surtout ceux qui sont en mesure de faire des émissions radiophoniques avec le concours des journalistes, des médias sociaux et d’autres foras. En plus, discuter avec les présumés djihadistes pourrait aider. Par exemple, avec ceux arrêtés dans les prisons pour, comme la Mauritanie l’avait fait discuter du coran. En arrière-plan, l’objectif c’est de les faire comprendre que le combat qu’ils mènent est nul. Puisque nulle part, dans le coran le djihad est utilisé dans ces contextes.
Évidemment, qu’il a eu lieu mais c’était au moyen-âge. Mais dans un contexte, on va parler de protection de soi. Ces discours sont importants. On ne peut le faire qu’avec ceux qui sont les érudits du domaine. L’État doit veiller à ça. L’Etat doit également avoir une vraie attention sur les médias sociaux notamment WhatsApp. Parce que ce sont des médias à travers lesquels des groupes terroristes font recours pour berner les jeunes. Ou même les moins jeunes et véhiculent leur discours.
Face à la menace d’une implantation durable du JNIM dans les marges septentrionales des États côtiers, les stratégies de contre-terrorisme mises en œuvre au Togo ou au Bénin peuvent-elles réellement empêcher l’émergence de « couveuses locales » de radicalisation ?
Il y a peut-être plusieurs leviers d’action. Un des leviers d’action simple, c’est le dialogue civilo-militaire qu’il faut promouvoir. C’est également les comités locaux de veille de monitoring qu’il faut créer en s’appuyant sur les jeunes, les femmes, les leaders locaux, les influenceurs locaux. Le second point, c’est aussi une vraie volonté. En dehors des réunions quand un problème est constaté, il faut qu’on puisse apporter des solutions diligentes. Ceci afin que les gens puissent avoir confiance dans le mécanisme de résolution de conflits. Parce que si on les met en place et que lors des réunions à chaque fois, les mêmes constats sont évoqués et qu’il n’y a pas d’action, mais à un moment donné les gens vont s’impatienter. Ils vont dire bon, cela ne vaut pas la peine de continuer vers ces mécanismes-là.
Donc, il faudrait qu’il y ait aussi des réponses appropriées aux problèmes qui vont être constatés. Après, il y a des numéros verts qu’on peut mettre en place. De même que des collaborations directes sous forme de convention avec des journalistes dédiés avec des radios communautaires qui sont les plus écoutées. Je crois qu’il faut utiliser tous les mécanismes possibles pour que chacun se sente concerné. Le terrorisme étant une menace diffuse, il est important que la lutte requière la collaboration de tout le monde. C’est pareil pour des solutions concertées avec l’implication de tous les citoyens.
LIRE AUSSI :
- JNIM à la porte du Sénégal : Péril de l’arc sahélien
- Bakary SAMBE, Spécialiste du Sahel et des pays côtiers : « En Afrique de l’Ouest, l’avancée du Jnim est réelle »
- Hervé BRIAND, Senior Sahel Analyst : « Le Jnim est sans doute devenu ces derniers temps l’acteur le plus létal au Sahel »