Les villes africaines enregistrent un taux conséquent en matière de démographie. Ce qui nécessite que les politiques urbaines soient repensées dans la perspective de maîtriser le phénomène urbain. Pour une urbanisation “intelligente et durable’’, Beaugrain Doumongue, ingénieur du bâtiment, rappelle l’importance de « cocher durablement la case de la gouvernance ».
Propos recueillis par Arnauld KASSOUIN (Coll.)
Bénin Intelligent : Quelle appréciation faîtes-vous de la croissance urbaine en Afrique de l’Ouest ?
Beaugrain Doumongue : Les villes d’Afrique de l’Ouest, à l’instar de la majorité des villes africaines, se développent à très grande vitesse. Ce mouvement, pourrait-on croire, est surtout drainé par les capitales qui concentrent l’essentiel des populations des pays de cette zone. Loin s’en faut, car les pays d’Afrique de l’Ouest sont symptomatiques de ce qu’il est convenu d’appeler la macrocéphalie urbaine, caractéristique de pôles uniques qui mobilisent l’essentiel des populations.
C’est le cas d’Abidjan, Accra, Lagos et Lomé, villes portuaires, principaux centres économiques et symboles politiques, qui, du fait de leur position stratégique ont concouru à cette appréciation première. En réalité, la dynamique des petites et moyennes villes est plus subtile. L’Onu Habitat soulève, à cet effet, que 70% de la croissance urbaine se déroule dans les villes de moins de 500.000 habitants. C’est le lieu d’interroger un fond assez inexploré.
Qu’est-ce qui expliquerait la forte urbanisation dans cette sous-région de l’Afrique ?
Au-delà de l’activité économique des villes, laquelle attire naturellement des populations en grand nombre, l’urbanisation ouest-africaine est principalement le fait d’une forte croissance démographique dans la zone Cedeao et Mauritanie, qui représente plus de 37% de la population continentale.
En 2019, on estimait déjà que la population de la sous-région devrait connaître une évolution de +104% à l’horizon 2050 et +284% à l’horizon 2100 passant de 391 millions d’habitants (2019) à 796 millions (250) et 1.5 milliards (2100). Cela se justifie par ailleurs, par un taux de fécondité par femme, en Afrique de l’Ouest, de 2.71points supérieur à la moyenne mondiale et de 0.47 points supérieur à la moyenne africaine.
Cette explosion démographique est si réelle qu’au Bénin, la population totale a été multipliée par 5 entre 1960 et 2020, alors que dans la seule ville d’Abomey-Calavi, l’évolution démographique est telle que la population a également été multipliée par 5 entre 1992 et 2013. La concomitance de ces deux facteurs contribue à faire de l’Afrique de l’Ouest le premier pôle d’Afrique avec plus de 1700 agglomérations, dans un contexte où les distances qui séparaient les villes ont chuté de 65.52% entre 1950 et 2050, et continuent encore aujourd’hui.
Y-a-t-il des facteurs expliquant l’absence de politiques publiques sur l’urbanisation ? Si oui, lesquels ?
Dans la majorité des pays, le développement urbain est régi par des textes qui existent bel et bien et qui sont généralement qualifiés de politiques urbaines. Celles-ci brassent un large spectre de champs d’intervention qui vont des considérations sociales aux considérations culturelles en passant par l’urbanisme, la construction, les réseaux, le markéting urbain, etc.
Seulement ces textes souffrent parfois d’un défaut d’application, d’un défaut de décentralisation, d’un défaut de mise à jour et d’un défaut d’adaptation aux évolutions locales. Le temps qui s’écoule entre deux recensements généraux de la population et de l’habitat, par exemple, est généralement long et ne permet pas en temps réel une appréciation exacte, sous réserve des outils d’estimation statistiques, de l’influence des migrations diverses sur l’évolution réelle des populations, celle de l’habitat et celle des limites urbaines.
Il sied, à cet effet, de préciser que là encore, il existe une asymétrie de capacités, à l’échelle d’un même pays, entre les petites, les moyennes et les grandes villes, lesquelles ravissent la priorité du fait de leur niveau plus élevé de développement. C’est ce que révèlent, entre autres, les dynamiques de décentralisation en même temps qu’elles démontrent l’importance de la territorialisation de la norme pour stimuler un juste développement des régions et villes secondaires. A ceci, il faut sans doute ajouter l’approche sécante que l’on observe dans le fonctionnement des services de l’urbanisme vis-à-vis de ceux de la planification et de ceux de l’aménagement, dont l’action commune est requise pour une prospective urbaine aboutie.
Quelles sont les crises que l’urbanisation galopante pourrait générer aux États africains ?
Le surpeuplement des grandes villes et des capitales, en particulier, est une tendance qui s’accentue de plus en plus et qui va poser de nombreux défis en lien avec l’incapacité actuelle des villes africaines à produire et dynamiser la croissance par habitant. Une étude de la banque mondiale dénommée « Ouvrir les villes africaines au monde » et datée de 2017 démontre qu’à niveau d’urbanisation égal par rapport au reste du monde l’Afrique brandit un Pib par habitant de 71% inférieur à celui de l’Asie de l’Est, de 45% inférieur à celui de l’Amérique latine et de 43% inférieur à celui du Moyen-Orient, concluant ainsi que « l’Afrique s’urbanise en restant pauvre ».
L’une des raisons, et non des moindres, qui accentuera la pression sur les grandes villes et capitales du Golfe de Guinée (qui abrite 56% du PIB des pays concernés), reste le changement climatique. Cette zone tampon est critique parce qu’elle est menacée au sud par l’avancée de la mer (1.8m par an en moyenne) et au nord par l’insécurité et les problèmes climatiques qui vont accroître les déplacements de populations en direction de ces espaces.
La pauvreté et les inégalités mèneront à une crise certaine de l’habitat et du foncier, remettant en cause, dans le même temps, les limites déjà incertaines des principaux centres urbains, avec en sus des défis aux plans de la mobilité, de la qualité de l’air, des nuisances sonores, de l’énergie, de la salubrité, etc. Aussi, faut-il s’attendre à la hausse de la criminalité en ville qui pourrait contribuer à fragiliser les pays dans un contexte géopolitique et sécuritaire complexe.
Pensez-vous que les États aient perdu le contrôle du phénomène urbain ?
Ce serait être fataliste que de le relever comme une donnée. Aussi vrai que la ville soit par nature évolutive dans son contenu, le phénomène urbain est lui-même mutant dans l’espace et dans le temps. Il convient donc de relever l’importance pour les États de prendre à bras le corps la question urbaine, car en elle gît moult impératifs pour le développement.
Pour maîtriser le phénomène urbain, il faut agir en bonus pater familias. Pour cela, il importe de penser l’urbain dans une logique prospective et sans négation des contextes politiques, géopolitiques, sociaux et économiques qui restent une urgence aussi forte que la nécessité d’assurer davantage de planification pour faire des villes les reflets de la bonne santé et de la « bonne émergence » des pays africains.
Pourquoi doit-on repenser l’urbanisation selon-vous ?
Le véritable enjeu du développement urbain durable à l’échelle d’un pays c’est à la fois la cohérence et l’équilibre du développement de ses villes. Cela nécessite un développement équitable des activités, la territorialisation des compétences, une juste redistribution des richesses, la présence des services publics, la disponibilité des équipements socio-collectifs et une vision claire de l’orientation et du devenir des villes.
Ceci a pour avantage de développer les villes secondaires et d’en faire les réceptacles des migrations en direction des capitales et, dans le même temps, des pôles d’attractivité qui ne soient plus éblouis par la lumière des grandes villes. Ainsi pourrait se mouvoir à l’échelle d’un pays plusieurs dynamiques qui réhabiliteraient un meilleur équilibre de la répartition spatiale du développement. Mais pour cela, il faut produire la norme (urbanisme, aménagement, habitat, logement, etc.) de façon concertée, loin des pratiques top down, et veiller à son application. Afin que la ville reste un projet et un espace d’épanouissement collectifs.
Comment l’urbanisation peut-elle favoriser le rayonnement économique des États de l’Afrique de l’ouest ?
La ville a ceci de particulier qu’elle propose, toutes choses étant égales par ailleurs, de meilleures conditions de vie. Si cela attire énormément, c’est parce que la ville offre également les meilleures opportunités, d’où une urbanisation qui mobilise dans les milieux urbains une main d’œuvre massive et donc en mesure de stimuler l’activité économique par la production et d’induire le développement économique.
Dans une logique où cet esprit serait équitablement mis en œuvre au-delà des grandes villes et capitales, le développement ne serait plus simplement la singularité des principaux pôles urbains, mais, dans une certaine mesure, le lot commun des villes du pays. En y rajoutant les possibles du branding national et du marketing territorial, il serait question d’associer au préalable que représente le développement économique les possibles de l’identité pour stimuler l’attractivité, promouvoir l’image de marque, mobiliser des partenaires, attirer des investissements et construire la compétitivité.
Si ce descriptif est plus simple à réaliser qu’à mettre en œuvre, il faut tout de même garder à l’esprit que toutes choses égales par ailleurs, les villes ne sont pas dotées des mêmes atouts naturels, géographiques, souterrains, historiques, etc. et que la décentralisation, au-delà des discours, n’est pas toujours une donnée. Il y’a donc en substance la nécessité de cocher durablement la case de la gouvernance pour asseoir une logique de développement sainement partagée entre villes et territoires.
L’urbanisation soulève d’importants défis en matière de planification, de gestion et de financement. Alors dites-nous ce que vous proposez pour une urbanisation intelligente et durable en Afrique de l’Ouest ?
L’urbanisation « intelligente et durable de la ville » africaine devrait, selon mon opinion, procéder d’une démarche en 4 temps : le dépoussiérage des plans d’urbanisme, la création d’une vision concertée du devenir des centres urbains en lien avec leurs ressources et capacités d’accueil dans une perspective de géopolitique urbaine, le développement d’atouts économiques locaux, la promotion de la mixité sociale et fonctionnelle et celle du développement durable.

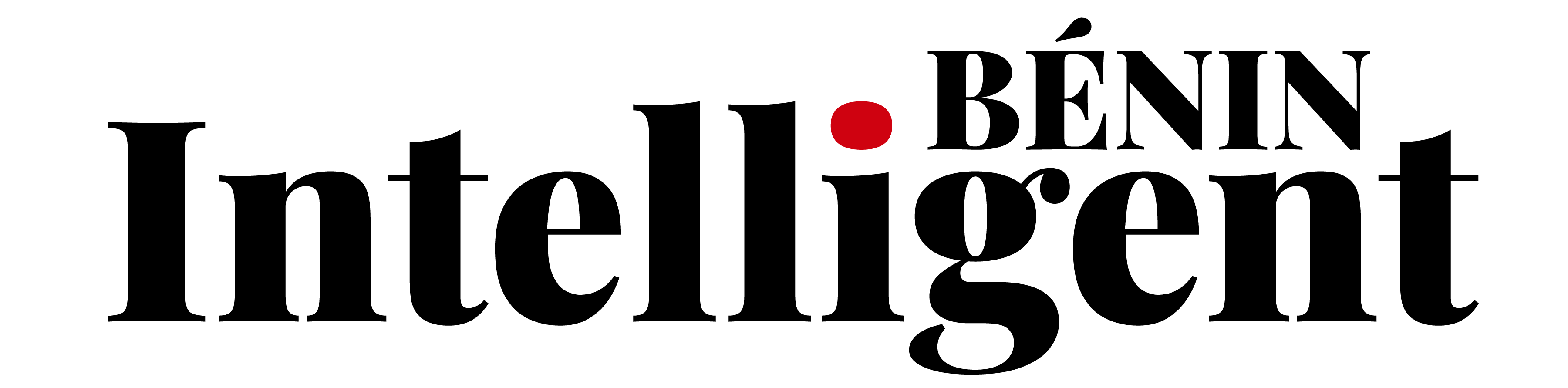




0 Commentaire
Une très bonne initiative. En tant que géographie, hygiène et sécurité environnementale. Je suis disponible pour d’éventuelles recrutements