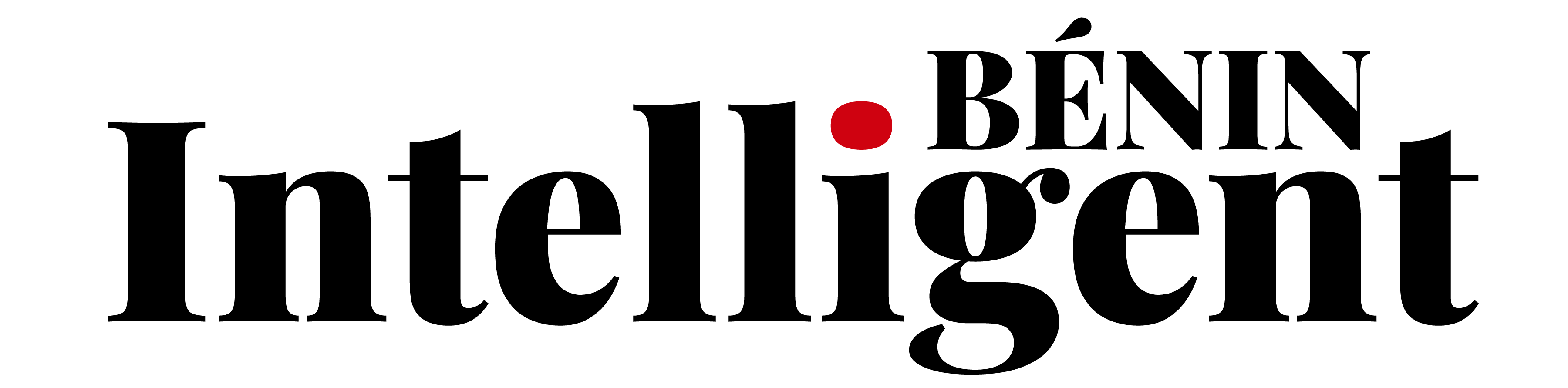L’Église est interpellée par l’actualité sociopolitique en Afrique qu’elle considère à juste titre comme l’un des poumons d’une humanité en crise (Africæ Munus, n° 177). Et cette Afrique, où elle connaît une certaine vitalité, compte désormais assumer justement son propre destin. Y arrivera-t-elle ? Elle a besoin d’y être aidée. Belle opportunité pour l’Église !
Le malheureux retour aux coups d’Etat au Mali, en Guinée, au Burkina-Faso, au Niger est paradoxalement supporté par l’effervescence populaire et justifié par la menace et les violences terroristes. Par ailleurs, après le Bénin et la Côte d’Ivoire qui auront certainement l’intelligence de juguler les crises politiques en leur sein, le Sénégal est de nos jours empêtré dans de graves tourments politiques. Les mutations ou crises en cours, dans ces pays, toutes des anciennes colonies françaises, sont soutenues par des discours panafricanistes tous azimuts, jouant sur la fibre culturelle et sur fond d’ostracisation.
Face au désespoir, la jeunesse africaine est aux abois. Certains bravent la Méditerranée à l’assaut de l’Occident. D’autres, de plus en plus nombreux partent en déportation volontaire en Europe pour des études et l’insertion professionnelle. Et la jeunesse restée au pays ne comprend pas le drame de cette Afrique si riche, mais appauvrie et qui enrichit d’autres…
L’Église ne peut rester indifférente à cette odyssée politique africaine. La foi chrétienne s’intègre dans la réalité sociopolitique qu’elle informe. Les deux spécificités de la foi chrétienne, la Trinité et l’Incarnation rédemptrice, constituent un engagement de Dieu dans l’histoire des hommes, pour une communion avec Lui dans l’au-delà, mais dont les effets commencent sur la terre. La tension eschatologique qui détermine la vie chrétienne engage et oriente les enjeux temporels :
L’Église en Afrique est convaincue (…) que l’attente du retour final du Christ ‘‘ne pourra jamais justifier que l’on se désintéresse des hommes dans leur situation personnelle concrète et dans leur vie sociale, nationale et internationale’’ : parce que les conditions terrestres influent sur le pèlerinage de l’homme vers l’éternité. (Ecclesia in Africa, n° 139).
Le chrétien ne s’évade pas des enjeux terrestres :
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. (Gaudium et spes, n° 1).
La prière chrétienne porte à l’action comme dans le cas de la reine Esther. Prier l’action et agir à partir de la prière. Au regard de la croissance de l’Église en Afrique, de sa vitalité certaine dans l’Église universelle et des défis de son implantation de nos jours remise en cause, la géopolitique africaine en cours interpelle l’Église.
1-L’Église universelle à l’épreuve de la crédibilité
Dans l’Église universelle, l’Église en Afrique a une certaine place. Dans mon ouvrage, L’Afrique a-t-elle un avenir avec l’Église ? Leurres et lueurs, j’ai indiqué des axes où l’effort doit se poursuivre. Pour l’occurrence, la belle expérience de foi des Journées Mondiales de la Jeunesse se déroule au Portugal. Elles ont déjà eu lieu 9 fois en Europe, 5 fois en Amérique, 1 fois en Asie, 1 fois en Océanie.
Elles se sont déjà déroulées dans tous les continents, sauf en Afrique Et pourtant, c’est en Afrique que se trouve la plus grande densité de la population jeune qui se presse et se mobilise avec fort enthousiasme les dimanches des rameaux et depuis un certain temps, les dimanches du Christ Roi. Sur cet angle, mutatis mutandis, l’Église aurait-elle accompli moins que des structures profanes qui ont tenté et tenu la gageure des Coupes du Monde du Football en Afrique ? Pourvue de sa vitalité, la voix de l’Église en Afrique compte-t-elle vraiment ?[1].
Les rapports de l’Église universelle avec l’Église en Afrique ne peuvent se réguler sur les modalités des rapports du monde.
Par ailleurs, mon ouvrage, L’Afrique peut-elle évangéliser l’Afrique ? soulignait que l’Église universelle doit veiller à ce que les modalités actuelles de la mission de l’Église en Afrique vers l’Europe ne s’embourbent dans les ambiguïtés historiques de la mission de l’Europe vers l’Afrique. Pour ce faire, l’Église en Afrique a la responsabilité de se manifester comme un sujet ecclésial responsable. Aussi lui faut-il des pasteurs à la hauteur des enjeux, choisis sur des profils d’engagement éprouvés.
Au moment où l’Afrique rêve d’espérance, l’Église a la mission de lui faire naître de nouveaux chemins d’espérance. Elle peut, à cet effet, capitaliser toute la pastorale prophétique du saint pape Jean Paul II en Afrique[2]. Benoît XVI a recommandé un changement de regard sur l’Afrique (Cf. Africæ Munus, n°5) : « J’ai uni au mot Afrique celui de l’espérance… », avait-il déclaré. Le pape François a rappelé cette dynamique lors de son dernier voyage au Congo. L’occurrence du synode à Rome constitue un Kairos pour réfléchir, même en marge des assemblées, à la situation de l’Afrique..
2– L’Église-sœur de l’Occident face à sa responsabilité historique
L’Église en Afrique porte le poids de la collusion de l’évangélisation avec l’esclavage et la colonisation. Les missionnaires qui ont évangélisé notre Afrique proviennent de l’Occident chrétien. L’Église en Occident auquel s’assimile faussement l’Évangile, doit affronter ces contingences sociopolitiques basées sur le rejet d’une certaine politique, surtout celle de la France, fille dite aînée de l’Église. Malgré la laïcité qui n’est pas indifférence, il lui revient d’éveiller la conscience de ses responsables politiques. Une prise de position publique du Conseil des Conférences Episcopales de l’Europe témoignera éloquemment que le projet des missionnaires, malgré les ambigüités qui l’ont entouré, est réellement différent de celui des colons.
Au niveau ecclésial, la requalification de la mission s’impose comme l’a analysé Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, dans son article « Mission en Afrique : De la contestation à la requalification »[3]. Des décisions courageuses sont à prendre par rapport aux modalités de la mission pour que celle-ci ne se transforme en traite ecclésiale, comme évoqué dans L’Afrique peut-elle évangéliser l’Europe ?
La proposition de bourses d’études devient ainsi un subterfuge pour régler matériellement les problèmes de pénurie des prêtres en Europe. Pour le besoin de main-d’œuvre, est donc proposée aux diocèses en recherche d’étude pour leurs prêtres, une bourse pour employer pastoralement ces derniers. Ils travaillent ainsi pour payer leurs études. Et ce travail serait la messe ! Pauvres prêtres d’Afrique ! Ce mécanisme traduit la permanence, sous une forme plus subtile, du mépris originel de l’Europe vis-à-vis de l’Afrique. L’aide, en mode ecclésial, devrait être désintéressée. Il faudrait donc urgemment détacher l’aide aux études de la mission. Combien de diocèses seraient prêts à aider l’Église en Afrique à faire étudier ses prêtres, en accordant des bourses sans attendre structurellement rien en contrepartie ? Les Églises en Europe en seraient-elles capables ? Les Églises en Afrique seraient-elles prêtes à cette mesure qui réduirait drastiquement le nombre de la présence de leurs prêtres pour raison d’études ? La mission est noble ; il faut éviter de lui appliquer des méthodes de l’esprit du monde.[4]
A la première assemblée spéciale du synode des évêques pour l’Afrique en 1994, des Evêques d’Afrique avaient déjà adressé et signé une lettre ouverte à leurs frères Evêques d’Europe et d’Amérique du Nord pour que ceux-ci pèsent de tous leurs poids sur les questions de l’endettement du Tiers-monde, spécialement d’Afrique. A l’Église qui en Europe et en France, se pose cette question relative à l’Afrique et à l’Église en Afrique : « Qu’as-tu fait de ta sœur ? ». Par elle, le Christ est méprisé, bafoué, opprimé…
3-L’Église en Afrique, un sujet ecclésial responsable
Les mutations en cours en Afrique interpellent et engagent au premier plan l’Église en Afrique qui ne manque pas de dynamiques panafricaines dont elle possède structures et ressources. Mais l’unité africaine ecclésiale n’est-elle pas autant essoufflée que nos organisations socio-politiques ? Nos organisations ecclésiales régionales ou sous-régionales assurent-elles la coordination pastorale de manière effective et effective ? La Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest francophone (CERAO) et l’Association of Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (AECAWA) se portent-elles mieux que la CEDEAO ?
Si la CERAO et l’AECAWA n’ont rien à dire dans cette crise qui secoue l’Afrique de l’Ouest, quelle est leur pertinence ? Au cas échéant, ce serait une dé-mission. C’est un test de synodalité active.
Pour plus d’efficience, la qualité des engagements sociopolitiques de l’Église en Afrique a besoin d’une veine plus prophétique qui consiste à annoncer, à dénoncer et à renoncer à[5]. Nos modes pour annoncer et dénoncer sont-ils pertinents dans une Afrique dite incurablement religieuse et où le sentiment religieux s’effrite de plus en plus même, dans une Afrique dont plusieurs de ses fils contestent la présence de l’Église au regard de l’ambiguïté de son entrée sur le continent. Ce regard assez sommaire fausse certes la réalité, mais il a le vent en poupe dans les milieux panafricanistes. L’histoire de la mission est bien plus complexe que ces présentations idéologiques et caricaturales. Toutefois, celles-ci nous imposent une nouvelle posture.
Avec les partis uniques, l’Église en Afrique a connu une traversée du désert des années 1960 à 1990. Par sa présence aux côtés de la population, elle a été un acteur majeur dans le vent de démocratisation. Elle a ainsi acquis un réel crédit sociopolitique qui perd de plus en plus sa teneur. La pastorale paraît déconnectée des enjeux historiques. Elle se contente néanmoins de quelques déclarations fortes.
En Côte d’Ivoire, face au drame d’un troisième mandat, l’archevêque d’Abidjan avait vivement recommandé le respect de l’ordre constitutionnel. Et c’est même sur le parvis de la cathédrale que des hommes politiques parmi lesquels des chrétiens, l’ont désavoué. A l’issue de la dernière assemblée de la Conférence des évêques de la Côte d’Ivoire, leur président, Mgr Marcellin Kouadio, a vertement et ouvertement dénoncé les dérives politiques. Aurait-il été écouté ?
Au Congo, l’Église s’était manifestement mobilisée pour le changement de régime. La modalité du changement aurait-elle honoré la vérité des votes ? Le samedi 24 juin 2023, au jubilé d’argent de Mgr Emmanuel Bernard Kasanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui la parole a été malheureusement donnée, s’en prit violemment à l’Église qu’il accusa de partialité.
Au Togo, l’engagement socio-politique de Mgr Kpodzro est manifeste comme lors des dernières élections présidentielles. L’image de ce nonagénaire réclamant la libération de son pays est pathétique et historique. Mais ne manquerait-il pas quelque chose à toute cette légitime dénonciation du mal socio-politique ?
Annoncer, dénoncer et renoncer à, requiert aujourd’hui plus que jamais de former, de revoir les méthodes d’approche, d’accompagnement de nos cadres et personnalités politiques. Ce service est variable comme le soulignait M. Paul Kiti, enseignant de Philosophie à l’UAC (Bénin), lors de la Cérémonie académique à l’EITP le 24 avril 2021 :
Pour certains, ce service prend la forme d’une présence aimante aux pauvres, aux malades, aux plus démunis, aux opprimés de tout genre (…). Pour d’autres, il prend la forme du ministère de l’éducation, de la formation intellectuelle et théologique. Pour d’autres encore, il prend la forme de l’engagement sociopolitique, de la dénonciation des injustices sociales et structurelles et d’un effort pour la construction d’un espace social et politique où règnent la justice, la liberté et le respect du bien commun.
Pour ma part, j’évoquais déjà dans La Croix Africa du 5 juillet 2019 :
Si notre parole semble de plus en plus banalisée, serait-ce seulement à cause d’une réelle présence active de structures ou d’obédiences hostiles à la foi chrétienne et à l’église ? Ne devrions-nous pas aussi interroger la responsabilité des modalités de notre pastorale sociopolitique et de l’ambivalence de certaines de nos attitudes ou prises de position ?
Par ailleurs, la synthèse de l’Église du Bénin pour le synode sur la synodalité soulignait la nécessité de « l’amélioration de la qualité de la parole sociopolitique de l’Église ». J’expliquais ainsi ce nouveau paradigme à La Croix Africa du 14 juin 2022 :
Une relative banalisation du discours sociopolitique de l’Église est apparente. Les causes ne peuvent être seulement réduites à la montée d’un certain anticléricalisme ou à la remontée d’obédiences ésotériques. Nous devons évaluer notre méthode pastorale, reconnaître nos lieux de compromission et veiller à la qualité de notre propre gouvernance ecclésiale.
Le changement de paradigme nécessite un engagement à convaincre davantage de la pertinence de nos principes ou recommandations légitimes. Nous vivons désormais dans une société plurielle émancipée. Il ne suffit donc plus que nous ayons parlé pour être écoutés. Au regard des enjeux politiques africains, nous devons être prêts à rendre raison de notre espérance sociopolitique par l’éducation aux valeurs, la création d’espaces de dialogue critique, le recours à des études approfondies afin que nos paroles ne soient perçues, quelquefois justement, comme assez banales : gratis affirmatur, gratis negatur.
Des paroles banales, souvent élaborées peut-être plus à contretemps qu’à temps ne peuvent porter. Il nous faut impérieusement soigner davantage nos textes et prises de parole, aussi bien dans le fond que la forme. Et ce soin dépend aussi de la qualité des hommes qui la portent. Il s’agit moins de diplômes que de compétences avérées et éprouvées. Qu’est-ce qui détermine alors le choix des hommes et femmes qui nous représentent ? Revoir urgemment la mission et le format de nos aumôneries des cadres et personnalités politiques en évaluant leur qualité et capacité d’accompagnement ne s’imposerait-il pas alors ?
La mission de l’Église auprès des hommes et femmes politiques se structurera autour de l’éducation des consciences, des cœurs et des mentalités. L’Église en a les ressources à travers sa Doctrine sociale dont les principes peuvent être appliqués par tout homme. Cette mission d’accompagnement qui commencera depuis la catéchèse intégrera les forces armées dont il faut redynamiser urgemment et de manière organique les aumôneries et aussi les acteurs judiciaires, du fait de l’instrumentalisation constante de la justice. « Un soin pastoral particulier est à accorder à ceux qui pratiquent et exercent le droit et la justice, une forme de participation au pouvoir de Dieu. En effet, le droit et la justice sont déterminants pour l’avenir des sociétés africaines : les problèmes politiques naissent presque toujours de leur manipulation »[6].
Au regard de la violence des vents panafricanistes, l’Église et l’Église en Afrique doivent affronter à nouveaux frais la problématique de la rencontre entre foi et culture, empoignée jadis par ses Pères, pour indiquer en quoi l’Évangile qui n’est pas occidental transcende toute culture qu’il purifie, en quoi son message rejoint et dépasse nos diverses quêtes de Dieu. La quête de l’identité africaine devient une priorité pastorale majeure. La libération qu’attend l’Afrique de l’Église ne peut être seulement spirituelle, bien que celle-ci soit la plus déterminante. Elle doit se déployer en libération socio-politique, par l’arme la plus terrible qui soit, l’éducation qui ne réussit que là où il y a l’amour.
Pour l’Église en Afrique, trois lieux essentiels paraissent essentiels pour sa pertinence africaine et son efficience sociopolitique. Ces lieux constituent la trame de l’Afrique a-t-elle un avenir avec l’Église ? : la liturgie, lieu de rencontre et de structuration de l’homme intérieur, la formation à tous les niveaux et l’engagement dans l’histoire. Les temps s’y prêtent…. Ces trois instances de l’Église évoquées plus haut sont appelées à s’engager pour l’Afrique, en modalité synodale. Il faut en définir les axes qui conviennent en ces temps d’une nouvelle configuration de la géopolitique africaine.
Rodrigue Gbédjinou
Prêtre du diocèse de Cotonou (Bénin)
gberodrigue@yahoo.fr
[1] R. GBÉDJINOU, L’Afrique a-t-elle un avenir avec l’Église ? Leurres et lueurs, Les Éditions IdS, Cotonou, 2021, 39.
[2] Cf. R. GBEDJINOU, Jean-Paul II, le pape de l’Afrique. Reconnaissance africaine, Éditions Francis Aupiais, Cotonou, 2010.
[3] Cf. N. BARRIGAH-BENISSAN, « Mission en Afrique : de la contestation à la requalification », in N. Y. SOÉDE, P. POUCOUTA, L. SANTEDI (éd.), Culture, Politique et Foi en Afrique. Mélanges en hommage au P. Efoé-Julien Pénoukou, Éditions Paulines & Éditions ATA, Abidjan, 2019, 561-578.
[4] R. GBÉDJINOU L’Afrique peut-elle évangéliser l’Europe ? Vérité sur la mission et responsabilités des Églises, Les Éditions IdS, Cotonou, 2017, 81.
[5] L’Église ne met pas son espérance dans les privilèges offerts par le pouvoir civil. Bien plus, elle renoncera à l’exercice de certains droits légitimement acquis, s’il est reconnu que leur usage peut faire douter de la pureté de son témoignage ou si des circonstances nouvelles exigent d’autres dispositions » (Gaudium et spes, n° 76)
[6] R. GBÉDJINOU, L’Afrique a-t-elle un avenir avec l’Église ?, note de bas de page 99, 111.
LIRE AUSSI: La justice, source de nos malheurs en Afrique ? Le défi de sa requalification