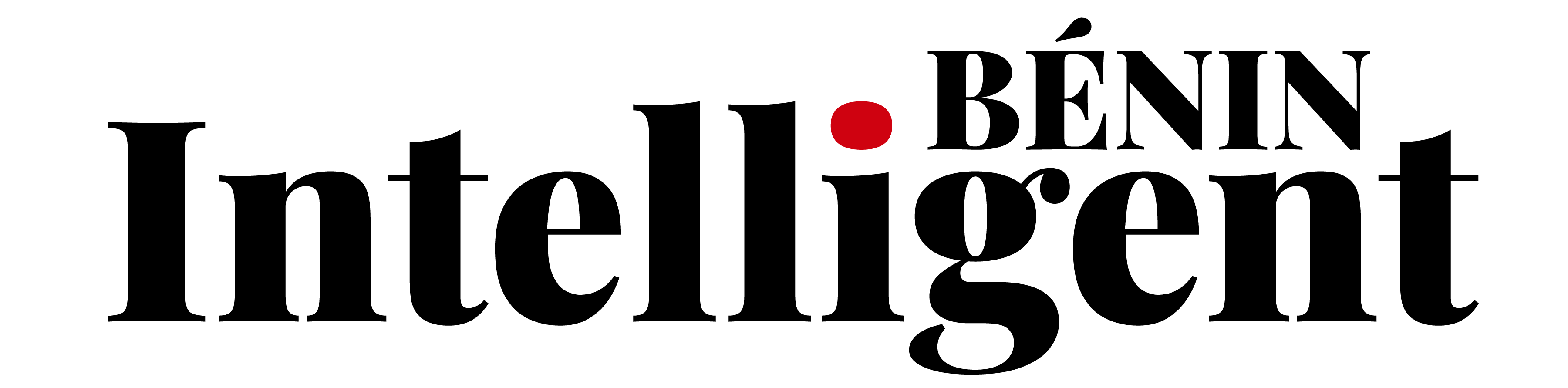Ce vendredi 22 mars, la Journée mondiale de l’eau (Jme) édition 2024 se tient sur le thème « L’eau pour la paix ». Au Bénin, selon des statistiques de 2023, le taux de desserte en eau potable est de 71,8% en milieu urbain. Dans les zones rurales en revanche, du nord au sud, « des femmes marchent encore sur plusieurs kilomètres, à la quête de ce liquide précieux ». Reportage à Koguédé…
Rejoignez notre chaîne WhatsApp
En cette fin de matinée du 19 mars, à Koguédé Maïkpin, un village situé à une trentaine de kilomètres de la ville d’Abomey (Sud-Bénin), une centaine d’hommes, femmes et enfants, dans une ambiance enjouée, accueille, au rythme de chants et danses, l’équipe de la Caritas diocésaine. La population vient ainsi exprimer leur gratitude en souvenir des tristes années où elle était sans eau potable.
« Nos aïeux avaient creusé une fosse dans laquelle ils recueillaient l’eau de ruissellement pendant la période pluvieuse. Cette eau, on la prélevait ensuite, la traitait pour en faire de l’eau à boire » se rappelle, avec profonde tristesse, Eugène Kingbè, 45 ans, un habitant du village. S’alimenter de cette eau, entraînait « de nombreuses maladies hydriques et dermatologiques qui n’épargnaient ni enfants, ni adultes ». « Tous nos maigres revenus se dissipaient alors dans les dépenses à l’hôpital », renchérit Sohoun Rosaline, une mère de famille.
LIRE AUSSI :
Services d’eau et d’assainissement : 52% de béninois non satisfaits
Dans un tel contexte, les habitants de ce village de la commune de Za-Kpota saisissent la Caritas diocésaine d’Abomey qui, à son tour, sollicite l’appui de Gruppo Missionario Merano, une association italienne. En février 2023, la population de Koguédé réceptionne émerveillée l’infrastructure. « Un forage muni d’un château composé de deux tanks de 5000 litres chacun et d’un système de pompage solaire » décrit le père Jérôme Boko, directeur diocésain de la Caritas, qui précise que c’est le 12e ouvrage du genre implanté dans des villages du diocèse grâce à ce partenariat.
La situation au Nord-Bénin
Situations similaires au Nord du pays, à Parakou comme à Natitingou ou encore, dans le département de la Donga. Ici, le père Pacôme Djimèzo constate que « trouver de l’eau potable pour les besoins de la famille est une réelle corvée, surtout pour les femmes ». Celles-ci « doivent marcher sur des kilomètres pour aller chercher ce liquide précieux à la rivière ou le tirer péniblement de puits ouverts, impropres à la consommation humaine ».
Que faire ? La Caritas diocésaine adopte une approche en deux étapes : « d’abord, aller vers les populations pour les écouter et évaluer leurs besoins en eau, ensuite, chercher avec eux et trouver des partenaires pour le financement des ouvrages : construction de forages, châteaux d’eau, puits, etc. ».
Cela a permis, en 2019, de réaliser les forages de Barei et de Gnongambi au profit de groupements de femmes; idem à Akoya un village frontalier du Togo, Gangamou, Kikélé, etc. De quoi sonner, dans ces villages, le glas de situations où les hommes devaient avoir des mares d’eau en partage avec des éleveurs qui y abreuvaient leur bétail, situations confligènes.
« Source de vie, l’eau peut aussi être source de conflits »
Pour l’édition 2024 de la Journée mondiale de l’eau, la communauté internationale a retenu le thème : « L’eau pour la paix ». Pour Alain Tossounon, « ce thème revêt toute sa pertinence vu que la rareté de l’eau peut, aujourd’hui, menacer la paix entre les peuples comme c’est le cas dans plusieurs pays en conflits, au Soudan ou en Syrie ».

«Les pénuries d’eau en période de sécheresse constatées au niveau des cours et plans d’eau, sont, en partie, à l’origine des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans notre pays »
Quant au cas précis du Bénin, ce journaliste spécialiste d’eau et assainissement, estime que « les pénuries d’eau en période de sécheresse constatées au niveau des cours et plans d’eau, sont, en partie, à l’origine des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans notre pays ». Interrogé, le père Djimèzo, directeur diocésain de la Caritas à Djougou (Nord-Bénin) confirme que « les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne cessent de causer assez de morts dans le diocèse avec comme cause principale, le manque de couloirs de passage et d’ouvrages hydrauliques résilients aux changements climatiques et adaptés à l’abreuvement du bétail ».
Au Sud du pays également, tout n’est pas rose. À Towodjèzoussè-Gogokoutin par exemple, un village où coexistent plusieurs hameaux dont ceux de peulhs –éleveurs de bœufs–. « Le besoin de l’eau dans cette localité a créé beaucoup de conflits entre éleveurs et villageois parce que les bœufs viennent s’abreuver aux mêmes sources d’eau que les habitants autochtones, ce qui pose un problème d’hygiène à la base de rivalités, d’agressions et de violences » se désole le père Boko qui vient d’y faire implanter un forage d’eau.
Reportage de Juste HLANNON (à Koguédé Maïkpin, près de Za-Kpota)
LIRE AUSSI :