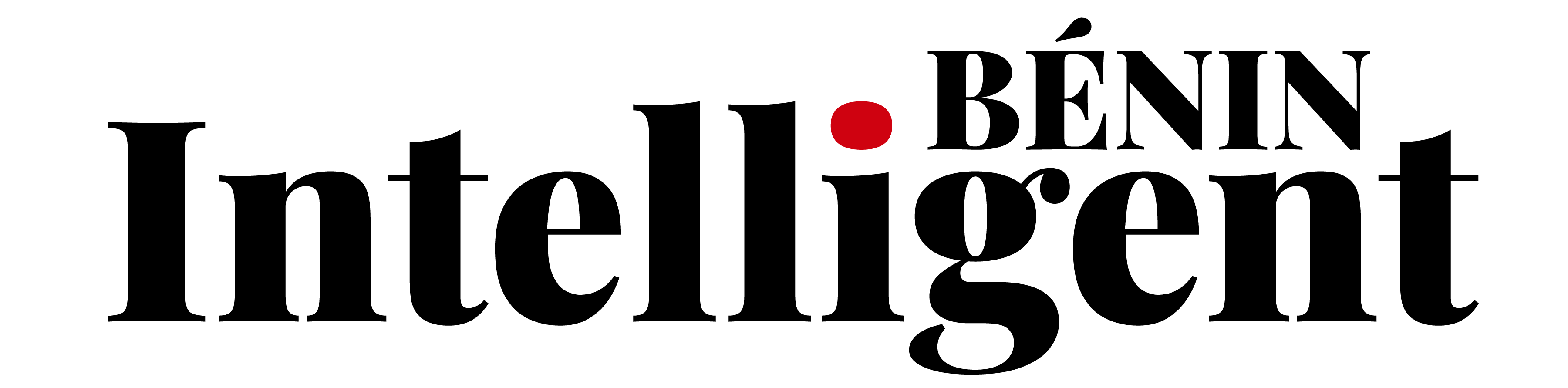Le JNIM à la porte du Sénégal. En effet, le JNIM constitue une menace pour la zone des trois frontières du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Timbuktu Institute a publié lundi 28 avril un rapport sur le sujet. Le rapport de 16 pages propose une analyse approfondie sur le JNIM à la porte du Sénégal à travers les trois frontières. Dans un premier temps, il examine les activités du JNIM dans la région, ainsi que ses stratégies d’infiltration économique et territoriale. Ensuite, il s’est penché sur les facteurs de vulnérabilité dans les cas sénégalais et mauritaniens susceptibles. Enfin, des recommandations ont été formulées pour renforcer la sécurité et la résilience communautaire face à cette menace transnationale.
Le JNIM à la porte du Sénégal, c’est une réalité. En tout cas, c’est ce que révèle le Rapport Timbuktu Institute, Avril 2025. Les nombreuses interpellations ayant eu lieu pour des faits de terrorisme confirment aussi bien cette assertion. Le démantèlement de cellules affiliées à Al-Qaïda entre le 20 et le 23 décembre 2021 conforte également l’idée avancée. Aujourd’hui, la menace se caractérise par des « actions du Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) dans le sud-ouest du Mali ». Frontalier avec la Mauritanie et le Sénégal. Il aurait même « augmenté de façon exponentielle ses activités à Kayes. Région frontalière du Mali avec la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal », renseigne le rapport de Timbuktu. Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans une logique d’expansion vers d’autres surfaces territoriales. Cependant, des analystes avertis s’accordent sur le fait que l’objectif du groupe ne serait nullement d’atteindre l’océan Atlantique.
« Pourquoi le ferait-il ? » objecte Wassim Nasr, journaliste et spécialiste des mouvements jihadistes. Et ce, dans une interview accordée à Bénin Intelligent. « Même s’il le voulait, il n’a pas les moyens d’arriver sur la côte et de pouvoir la contrôler », poursuit-il. Mais pourquoi s’intéresserait-il à la région des trois frontières ? Le JNIM à la porte du Sénégal, est-ce utopique ? Non ! D’ailleurs, le rapport d’avril 2025 de Timbuktu y a apporté de la clairvoyance. D’une part, ledit rapport indique que le JNIM serait déjà infiltré sur le territoire sénégalais. « Il a déjà infiltré de manière illicite des secteurs économiques clés, tels que l’exploitation forestière et minière, qui dépendent des échanges avec la Mauritanie et le Sénégal », précise Timbuktu Institute. D’autre part, « la frontière du Sénégal avec le Mali est déjà largement exploitée par les contrebandiers et sa géographie rend sa sécurisation plus difficile », lit-on.
Facteurs de présence
« Le Sénégal est préservé du terrorisme, mais il faut rester vigilant », arguait déjà en 2019 Gilles Yabi dans les colonnes de la Deutsche Welle. Six ans plus tard, il n’est plus seulement question de vigilance. Mais plutôt d’action et de renforcement des politiques sectorielles de sécurité. Dans le même sens que Gilles Yabi, directeur de Wathi, on peut également noter que des approches d’analyse sont proposées. En effet, dans « Le Péril jihadiste à l’épreuve de l’islam sénégalais », par exemple, on peut lire que « l’extrémisme religieux violent inspiré de l’islam, labellisé sous le terme de jihadisme, doit être approché avec attention dans le contexte sénégalais ». La donne n’a peut-être pas pour autant changé aujourd’hui. Fondamentalement, ce sont toutes ces grilles de lecture et d’analyse que convoque Timbuktu à travers son rapport sur le Jnim au Sénégal, avec un focus sur les trois frontières : Mauritanie, Mali et Sénégal.
Comme la plupart des pays ouest-africains, le Jnim constitue une potentielle menace pour le Sénégal. Selon le rapport, le groupe « semble avoir une stratégie à deux volets dans la zone des trois frontières ». L’objectif est d’« encercler Bamako et d’étendre sa zone d’opérations à certaines parties de la Mauritanie et du Sénégal ». Il suivrait « le même schéma que celui qu’il a utilisé dans les régions maliennes de Koulikoro et de Mopti ». Avec précision, l’expansion du Jnim à la porte du Sénégal s’explique par des facteurs de vulnérabilité exploitables au Sénégal. Il y a, par exemple, les « réseaux économiques transfrontaliers entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal » qui faciliteraient le recrutement et le transport de ressources (armes, explosifs) pour le Jnim. Le « déficit de prise de conscience des enjeux sécuritaires au niveau de la population » joue également en la défaveur du Sénégal.
Tendances
Bien que le Sénégal ne figure pas sur la liste des pays les plus vulnérables selon le Global Terrorism Index 2025, on note quelques tendances. Depuis quatre ans, par exemple, le « JNIM a multiplié par sept ses actions violentes dans la région de Kayes (Mali) ». En ciblant, de fait, « les forces de sécurité, les postes de douane et les convois sur les routes vers Bamako, la Mauritanie et le Sénégal ». « L’attaque de Melgué (février 2024), près de Bakel, illustre la menace croissante que représente le JNIM ». Selon le rapport de Timbuktu, le JNIM utiliserait « Kayes comme base pour pénétrer la Mauritanie et le Sénégal ». Il le fait en exploitant les frontières poreuses et les liens ethniques transfrontaliers. La Katiba Macina serait « la Katiba du JNIM présente dans la zone ».
Cependant, « la cohésion sociale, la modération religieuse et les forces de sécurité compétentes du Sénégal constituent des remparts solides. À condition, bien sûr, de renforcer la sensibilisation et de réduire les inégalités ».
Aucun pays n’est immunisé contre le phénomène. Bien que le Sénégal soit quelque peu à l’abri du phénomène, des faits confirment qu’il n’est pas à l’abri du choc sahélien. Ceci s’explique par un répertoire d’actions. Outre les facteurs précités, il y a, par exemple, le chômage couplé avec « les systèmes de castes dans la zone de Bakel ». Qui « perpétuent des inégalités et autres injustices dues à la stigmatisation de communautés entières ». Des « idéologues salafistes » utilisent « ces griefs pour influencer les croyances religieuses des individus », décrit le rapport. Ce qui n’est pas sans implications. Puisque cela rend potentiellement les gens « plus réceptifs à l’extrémisme violent en brandissant l’offre d’une “théologie de la libération” par rapport à l’islam traditionnel ». Au vu de ces constats, Mohamed Lamine Ouattara, expert en relations internationales, exhorte à l’impératif de renforcer la coopération entre les États.
D’une part, pour lui, on assiste au débordement de ce qui se passe au Sahel. D’autre part, il affirme que « nos intérêts sont liés ». Ainsi, « nous devons être capables de mutualiser nos efforts et d’aller vers des coopérations stratégiques, coordonnées et intégrées ».
Mohamed Lamine Ouattara
Ce rapport propose une analyse approfondie. Lire le rapport ici !