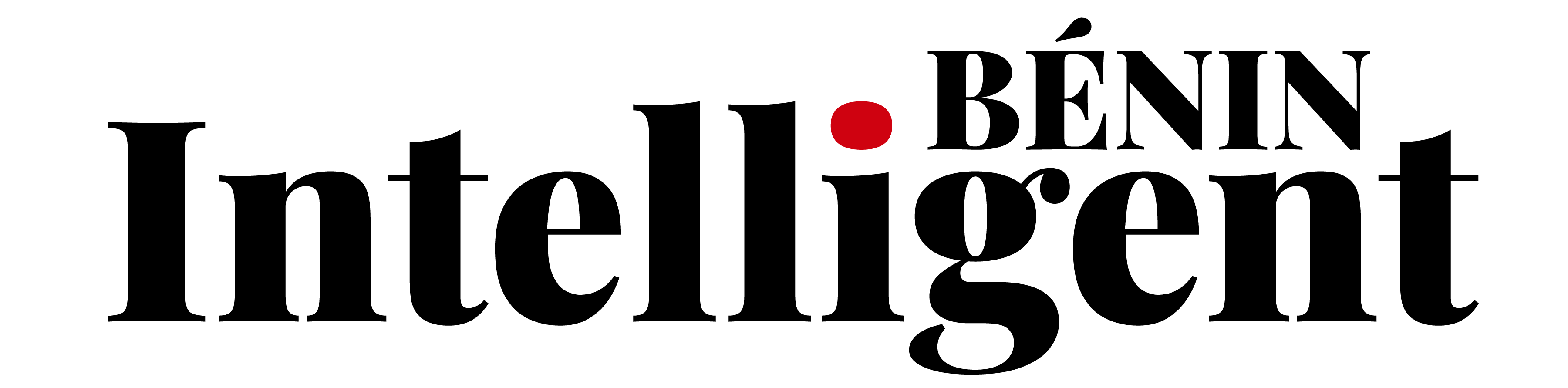Le Jnim a plus que triplé ses actions au nord du Bénin et du Togo. A quelle stratégie obéit cette nouvelle donne ? Le Jnim représenterait-il la seule menace des pays côtiers ? Dialoguer avec le Jnim est-il synonyme d’absence de pression militaire ? Quelle doit-être la posture des Etats côtiers face au Jnim ? De façon objective et analytique, Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes au Moyen orient et en Afrique a détaillé dans cet entretien les menaces qui fragilisent la situation sécuritaire des pays côtiers notamment du Bénin et du Togo.
Bénin Intelligent : Au nord du Mali, des signaux laissent entrevoir un rapprochement entre le JNIM et le Front de libération de l’Azawad (FLA), alors même que le groupe jihadiste privilégie historiquement les alliances islamistes ou les mouvements qui lui font allégeance. Peut-on y voir une inflexion idéologique significative ?
Wassim Nasr : Oui, on note une forme d’inflexion idéologique. Avant, ils se sont combattus, encore l’année dernière à la frontière avec la Mauritanie, puis sur certaines opérations contre l’armée malienne, ils se marchaient dessus. Il n’y avait pas de coordination proprement dite pour que des opérations militaires se fassent de manière concertée. Rien que pour ça, il fallait créer des canaux de discussion établis. Afin que cela ne limite pas à de simples coordinations ponctuelles. Du coup, il y avait eu cette déclaration que j’avais obtenue directement de la part des deux parties concernées (Jnim – Fla).
De fait, il y a eu des rapprochements. Il y a des choses très précises qui ont été discutées. C’est-à-dire, pour les incidents entre combattants de l’un et de l’autre, il y aurait un comité chariatique réactif chargé de statuer de l’incident. Ce dernier essaiera de trouver une solution. Ils ont aussi discuté de qui administrera les villes, jusqu’à comment faire en cas de prise de villes importante comme Tombouctou, Kidal etc. De même, ce qui est intéressant, sans entrer trop dans les détails, c’est que le Jnim a réussi à avancer l’idée auprès du FlA concernant l’application de la Charia. Tout en leur arguant qu’obtenir l’indépendance serait beaucoup plus complexe au vu des équilibres régionaux et internationaux. Que les pays concernés par la situation au Mali seraient plus enclins à accepter l’installation de la charia que de donner l’indépendance à l’Azawad.
L’argumentaire est le suivant « si vous voulez une administration indépendante ou autonomiste de l’Azawad, il faut que la junte à Bamako tombe. Si vous voulez que la junte à Bamako tombe, il faut que le facteur peul du Jnim donc de la Katiba de Macina et consort soit de la partie. Parce que les combattants peuls du Macina, même s’ils vouent soumission à Iyad Ag Ghaly, ils ne vont pas se battre pour l’indépendance de l’Azawad. Ils se battront par ailleurs pour faire tomber le régime de Bamako ». Il y a eu des discussions dans ce registre-là. Ces ajustements surviennent parce que les uns ont besoin des autres. Le Fla a besoin de la force de frappe du Jnim avec sa composante peule. Le Jnim quant à lui, dans son amorce naissante de désengagement de la mouvance Jihadiste internationale a besoin du Fla.
Dans un contexte où certains groupes, comme Hayat Tahrir al-Cham (HTS) en Syrie, ont pris leurs distances avec Al-Qaïda pour renforcer leur légitimité locale, pensez-vous que le JNIM pourrait emprunter une voie similaire ?
L’exemple du HTS n’est pas juste une question d’image. C’est un ajustement qui suit ce qu’on appelle « la jurisprudence du réel ». Théoriquement parlant, sans cet ajustement il n’aurait pas pu prendre Damas. La capitale syrienne n’aurait pas pu être prise sous la bannière d’Al-Qaïda. La démarche de Hts remonte à 2017. Ce désengagement d’al-Qaïda vis-à-vis de la mouvance jihadiste internationale avait pour but de se focaliser sur la Syrie, mais aussi de fédérer et d’inclure les autres composantes de la rébellion syrienne. Il faut aussi dire que les Talibans en Afghanistan ont fait une démarche similaire.
Ces deux exemples résonnent chez le Jnim qui était sur cette dynamique bien avant la chute du régime d’Assad et la prise de Damas. Ils y pensent au moins depuis la prise de Kaboul par les Talibans. Pour ce qui est du Hts que vous mentionnez, cela lui a pris début 2017 à 2024 pour prendre Damas. Et en 2025, donc une fois au pouvoir, pour donner les preuves irréfutables de désengagement vis-à-vis d’Al-Qaïda. C’est un processus qui prend du temps.
Le JNIM poursuit-il selon-vous une stratégie d’expansion territoriale durable ou s’agit-il simplement d’une logique de harcèlement destinée à fragiliser les États de la région ?
Je pense qu’il entame plusieurs politiques ou stratégies en même temps. Donc la stratégie d’expansion est réelle. Ils ont misé là-dessus. Sans rentrer trop dans les détails, ils dupliquent ce qu’ils ont fait du nord vers le centre du Mali. Puis, du centre Mali vers le Burkina Faso, et du Burkina Faso maintenant vers le Bénin et le Togo. Ça veut dire, qu’au-delà des attaques transfrontalières, ils arrivent à former des gens en capacité de recruter sur place, de noyauter ou de créer des insurrections dans leurs régions d’origine. On le voit de manière assez claire dans le parc W au Bénin ou dans les dernières attaques importantes au Togo. Où il y avait une vraie force du Jnim qui étaient transfrontalières et qui a réussi à suivre l’évolution des combats via drone etc…
Toutefois, tout ça fait partie de l’ordre du négociable. Quand on les questionne comme j’ai questionné Amadou Kouffa au sujet de l’expansion du groupe, c’est le numéro 2 du Jnim, dans sa réponse il laisse entendre que c’est de l’ordre du négociable. Ça veut dire que les dissidences peuvent être résolues de manière négociée. A partir de là, qu’est-ce qui est négociable et qu’est-ce qui ne l’est pas, ça revient aux décideurs des pays concernés d’en décider le moment venu. C’est-à-dire, quand un certain équilibre des forces est atteint ou du moins quand une vraie cartographie des capacités des forces en présence est établie. Par exemple, il revient au Bénin de décider s’il est opportun de négocier ou pas et à quel moment suivant quel équilibre des forces avec le JNIM.
Mais qui dit négociation, ne dit pas qu’il n’y a que la négociation. Évidemment, s’il y a négociation, elle sera couplée avec la force militaire. Puisque lorsque le Jnim parle de négociation et de résolution de conflit de la bouche même d’Amadou Kouffa, ce n’est pas pour autant qu’il arrête ses opérations militaires. Par ailleurs, il y a quelques jours une opération au Bénin. Donc, il ne faut pas que ce soit mal compris lorsqu’il s’agit de parler de négociation. La négociation n’arrête pas le fait militaire. Cela va de pair. Quand l’action militaire s’arrête, ou le niveau de violence baisse ou une route s’ouvre, grâce à la négociation, cela voudra dire que cette dernière avance.
Pensez-vous que l’objectif du Jnim serait d’atteindre le golfe de Guinée, notamment l’océan atlantique ?
Pas du tout. Pour être pragmatique, cela ne me parait pas du tout crédible. Parce que déjà, c’est très loin et bien au-delà de leurs capacités réelles. De deux, ça veut dire qu’ils vont essayer de contrôler des populations qui leur sont hostiles. Vers la Côte, ce ne sont pas des populations qui pourraient leur être acquises facilement comme les zones actuelles d’activités. Cela nécessitera des moyens considérables. En plus, ça va leur attirer à nouveau la foudre des puissances étrangères en particulier occidentales. Lesquelles leurs ont fait beaucoup du mal au Sahel. Il ne faut pas oublier quand-même que c’est à la faveur du retrait des français et des américains que les groupes jihadistes que ce soit le Jnim ou l’Etat islamique réussissent à se mouvoir librement sur une grande partie du territoire.
Je ne prétends pas que la présence occidentale soit une baguette magique. Car, elle n’a pas réussi à endiguer le problème, mais elle a réussi à l’entraver et à le contenir dans un espace limité. Alors, je ne vois pas ce que cela leur rapporterait de planter le drapeau noir sur la Côte. Je ne sais pas pourquoi certains agitent cette peur qui pour moi est un peu irréaliste. Encore une fois, même s’ils le voulaient, ils n’ont pas les moyens d’arriver sur la Côte et encore moins de la contrôler.
Le JNIM s’appuie sur une constellation de sous-groupes et de katibas à géométrie variable. Lequel d’entre eux vous semble potentiellement menaçant – pour la stabilité des pays côtiers ?
Il y a un paradoxe aujourd’hui. La branche du Burkina, comme je vous l’ai dit, du Mali au Burkina et du Burkina vers les zones frontalières des pays côtiers notamment au Bénin et au Togo est celle la plus menaçante. Puisque cette branche est en lien direct avec l’implantation au Bénin. Mais, le paradoxe est le suivant. C’est que cette entité qui est le Jnim qui pourrait être aussi dans une démarche de négociation est l’entité qui fait face à l’Etat islamique. Cantonné dans la zone des trois frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso. En plus, il a à peu près les mêmes bassins de recrutements que le Jnim. Et donc, si la digue constituée par le Jnim tombe, c’est l’Etat islamique qui va recruter au-delà vers les pays côtiers.
D’ailleurs, l’Etat islamique a déjà opéré au Bénin, c’était une unité transfuge du Jnim qui avait fait allégeance à l’Etat islamique. Finalement, qui a réglé son problème ? Eh bien c’est le Jnim, mais bien sûr au dépend de l’autorité de l’État béninois. C’est là tout le paradoxe.
Evidemment que le Jnim constitue une menace sécuritaire et politique. Mais c’est un acteur avec lequel il pourrait théoriquement avoir des négociations. Ou des canaux de discussions comme ce fut le cas avec le Burkina Faso ou le Niger et bien d’autres cas dans la sous-région. Cependant, si c’était l’Etat Islamique, là il n’y a ni de canaux de discussion ni de canaux de deconfliction. Encore une fois, je dis paradoxe parce que comment jauger du danger le plus immédiat. Est-ce que c’est l’un ou c’est l’autre ? ça revient aux pays concernés d’en juger, mais les deux sont présents.
L’exemple béninois est le plus parlant. Simplement parce que l’unité qui a voué allégeance à l’Etat islamique au Bénin, eh bien son compte a été réglé par le Jnim. Pourtant si le Jnim se renforce, c’est certes un danger politique et sécuritaire et s’il s’affaiblit complètement, c’est l’Etat islamique qui reprend les rênes. Dans de telles situations, qu’est-ce qui est mieux ? cela reviendra aux responsables politiques d’en juger.
Donc le groupe qui constitue le plus de menace pour le Bénin ce ne serait pas objectivement le Jnim mais l’Etat islamique ?
Je n’ai pas dit ça. En fait, l’Etat islamique est le groupe qui est le plus violent aujourd’hui. C’est un groupe qui ne veut pas négocier. C’était un peu ce que le Jnim faisait il y a quelques années et même dans quelques endroits encore au Burkina. Juste pour répondre à votre question, avec le Jnim il y a direction stratégique qui est prise par le commandement au Mali. Cette stratégie est suivie plus ou moins au Burkina par Jafar Dicko. Toutefois, il y a une grosse part d’incertitude. Parce que cela n’empêche pas que des décisions qui sont prises par la centrale concernant la violence à outrance ne soient pas forcément suivies par les branches. Par exemple, il y a eu des massacres au Burkina dont le Jnim, au niveau central, s’est désolidarisé.
Comment analysez-vous l’évolution opérationnelle du JNIM qui se caractérise par l’intensification des attaques ciblées sur positions des forces armées ?
Ils sont dans une logique où en deux mots, ils veulent gagner les cœurs et les esprits. En ciblant davantage plus sur les forces de l’ordre, c’est justement pour gagner les cœurs et les esprits des populations locales. C’est ce qui explique aussi le fait qu’ils n’ont plus recours en tout cas depuis 2017 aux attaques terroristes sur les hôtels par exemple. Comme ce fut le cas à Grand Bassam le 13 mars 2016, à Ouaga ou à Bamako etc. Après, par exemple, il y a eu une concertation sur les cibles militaires comme à Sévaré ou Kati, toutes les deux ont échoué. Dernièrement, l’attaque de Bamako en s’attaquant particulièrement à des cibles militaires.
Face à l’usage croissant de drones et d’armes modernes par les jihadistes, les États régionaux doivent-ils repenser leur propre recours à ces technologies ?
Ces technologies encore une fois ne sont pas des baguettes magiques. Quand elles ont été utilisées par les américains et les français, cela n’a pas pour autant mis un terme aux attaques djihadistes. Les drones que les américains et les français avaient sont des drones d’attaques de dernière technologie qui profitaient de renseignements satellitaires. Malgré cela, ce n’était pas la solution. Aujourd’hui ce qui est à disposition des pays du sahel comme des drones tb2 et Akinci au Mali (le Mali a perdu ses deux drones Akinci) c’est des drones certes qui ont une certaine efficacité. Mais ils sont onéreux. Les munitions sont onéreuses également. Puis, sans renseignement adéquat, ça finit par tuer beaucoup plus de civils que de djihadistes, qui par ailleurs arrivent à mobiliser les populations locales à cause de ces frappes indiscriminées devenues désormais la norme.
En sommes, ça ne résout pas le problème mais ils l’accentuent. Parce que plus ils tuent de civiles, par Wagner ou par milices interposées comme les Vdp avec toutes les horreurs qu’on voit depuis des mois, in fine ça ne fait que renflouer le rang des djihadistes. D’un autre côté, je pense que les groupes djihadistes ont la capacité rudimentaire de transformer les drones civils qui se trouvent sur le marché et qui sont pris dans les casernes des armés.
Toutefois, cet usage n’est ni généralisé ni tactiquement efficace pour le moment. Ils n’ont pas la capacité de faire porter de lourdes charges à ces drones. Les seuls à avoir réussi cela sont les rebelles Fla. On l’a vu pour la première fois pendant la bataille de Tinzawaten. On note aussi leur usage à titre de propagande. Mais surtout leur usage tactique qu’on a vu clairement lors de l’attaque de Diapaga au Burkina pas très loin du Bénin. Par exemple pour diriger les forces attaquantes et dévoiler le dispositif défensif de l’armée. C’est à dire qu’un drone n’est pas juste là pour filmer les combats. Il est aussi là pour diriger l’avancée des premiers attaquants et diriger les forces en conséquence. Franchement, cela est beaucoup plus important. Pourtant, personne n’en parle.
Face à la menace d’une implantation durable du JNIM dans les marges septentrionales des États côtiers, les stratégies de contre-terrorisme mises en œuvre au Togo ou au Bénin peuvent-elles réellement empêcher l’émergence de « couveuses locales » de radicalisation ?
Elles ne peuvent que contenir cette menace donc l’empêcher de se développer. La recette du Jnim encore une fois, c’est de planter les graines de l’insurrection avec des locaux. Je pense que le Bénin y est déjà. Après, ils peuvent la contenir. Ils peuvent arriver à une baisse de tension à défaut d’une pacification de la situation comme d’autres l’ont fait. Un peu comme la Côte d’ivoire. Les ivoiriens, eux ils ont réussi mais ce n’est pas que grâce à la force militaire. Parce que, c’est une combinaison de force militaire et de développement. C’est également de trouver les causes du problème et essayer d’y remédier. Qu’elles soient économiques ou sécuritaires, bien sûr.
LIRE AUSSI :
- Dr Bréma Ely Dicko: « L’extension de Jnim vers les pays côtiers est tout à fait logique »
- Bakary SAMBE, Spécialiste du Sahel et des pays côtiers : « En Afrique de l’Ouest, l’avancée du Jnim est réelle »
- Hervé BRIAND, Senior Sahel Analyst : « Le Jnim est sans doute devenu ces derniers temps l’acteur le plus létal au Sahel »