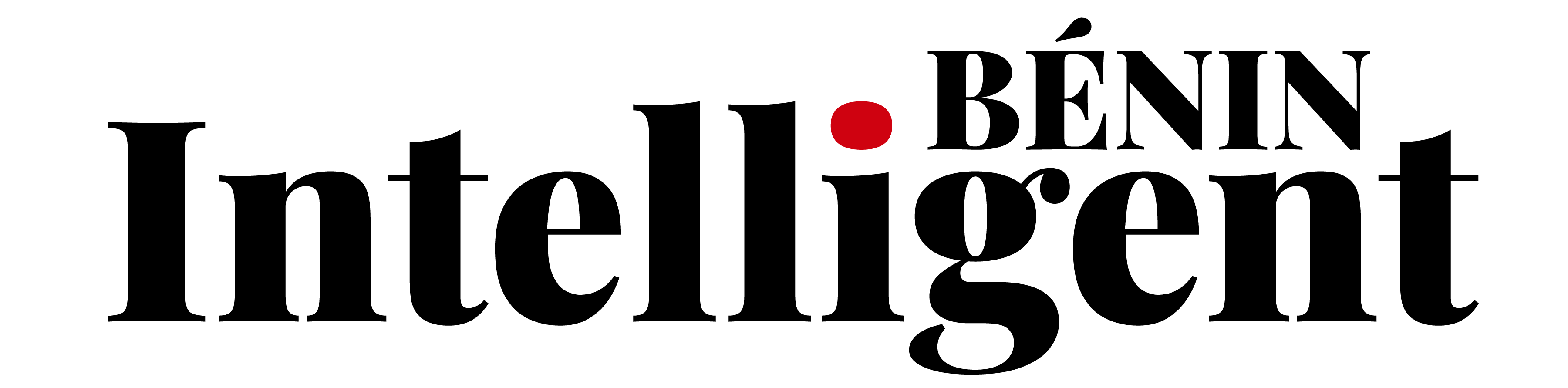L’extrémisme violent constitue l’une des préoccupations sécuritaires et sociales majeures de notre temps. Toutes les parties du monde en font, à des intensités et fréquences variables, la douloureuse expérience. Au Sahel, cette réalité ne cesse de se perpétuer, de s’ossifier. Pour tenter de le résorber, l’option répressive, militaro-sécuritaire a été longtemps privilégiée. Mais, elle s’avère aujourd’hui inefficace, voire contre-productive. D’où l’intérêt de plus en plus manifesté pour des réponses préventives, notamment l’importance des leaders religieux dans la prévention de l’extrémisme violent et les autres menaces à la paix et à la sécurité.
Par Arnauld KASSOUIN
L’extrémisme violent se caractérise beaucoup plus « par un écart de langage », précise Michel Alokpo, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. De ce fait, plusieurs sources et groupes – religieux, politiques, environnementalistes, ethno-nationalistes, peuvent bien conduire à l’extrémisme violent. Pour justifier la prise en compte de cette perception de l’extrémisme ou de la radicalisation violente, le professeur Jocelyn Bélanger, spécialiste des processus de radicalisation, écrit que « le principal facteur qui incite une personne à s’associer à un groupe radical, c’est la douleur sociale ».
En d’autres termes, l’idéologie survient dans un processus de radicalisation violente qu’après l’étape d’engagement car, « c’est avec le groupe [mention faite aux groupes de radicalisation violente, ndlr] que vient l’idéologie, le système de croyances », note J. Bélanger. L’idéologie est donc secondaire dans un processus de radicalisation. Toutefois, il convient de nuancer que l’extrémisme constitue une étape essentielle à franchir pour devenir un terroriste. Aussi, si, tout terroriste est à l’origine un extrémiste, tout extrémiste ne sera pas forcément un terroriste. Une personne extrémiste peut avoir des convictions et des principes indiquant son extrémisme idéologique, mais elle n’adopte pas la violence comme méthode pour atteindre ses objectifs et approuver les principes qu’elle adopte et auxquels elle croit.
D’ailleurs, « une éducation religieuse traditionnelle est même un contre-indicateur » dans un processus de radicalisation, a affirmé l’anthropologue américain Scott Altran, cofondateur du Center for the Resolution of Intractable Conflict de l’université d’Oxford. Par contre, des facteurs pouvant favoriser l’émergence et l’extension de l’extrémisme violent au Sahel et en Afrique de l’Ouest figurent des variables endogènes et exogènes.
Quant aux variables exogènes, il y a lieu de noter : la propagande extrémiste sur les réseaux sociaux, les répercussions du changement climatique, l’influence des groupes terroristes internationaux (l’Etat Islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans…)
Dans le catalogue des facteurs endogènes entrent des éléments tels que : les politiques monétaires et fiscales, politiques d’urbanisation et de décentralisation, la paupérisation urbaine, le sentiment de marginalisation ou de discrimination sociale, l’injustice sociale ou politique, les inégalités socio-économiques, l’absence de perspectives d’avenir, les conflits ethniques ou religieux, la corruption et la mauvaise gouvernance, les perspectives d’emploi limitées et les moyens d’existence insuffisants, la mauvaise interprétation des préceptes religieux ou encore, l’accessibilité des armes légères et de petite calibre.
Quant aux variables exogènes, il y a lieu de noter : la propagande extrémiste sur les réseaux sociaux, les répercussions du changement climatique, l’influence des groupes terroristes internationaux (l’Etat Islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans…), les ingérences étrangères dans les affaires politiques et économiques, la présence de groupes armées étrangères, les flux migratoires incontrôlés et les mouvements de réfugiés., la faiblesse des institutions étatiques. Tout compte fait, les facteurs endogènes et exogènes sont interdépendants.
Comme signe de l’extrémisme violent, on compte l’allégation de préférence ou d’intolérance vis-à-vis d’autrui. Considérant, ces dernières années, l’état de délabrement continue des cadres historiques et primaires de socialisation dans les États du Sahel, les « prescripteurs d’opinions et de conduite » tels que les leaders religieux deviennent des leviers essentiels et fondamentaux pour les politiques et les dispositifs de prévention, de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.
Le religieux comme instrument de lutte efficace
La plupart des sociétés africaines sont imbriquées dans une forme ou une autre de religiosité. En effet, la religion musulmane l’emporte sur le christianisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest (population estimée à plus de 920 millions au milieu de 2014), selon la fiche de données sur la population mondiale. Vu, le lien direct existant entre croyants et responsables religieux, il devient, sans nul doute, essentiel de souligner le rôle combien important de ces derniers « dans la prévention de l’extrémisme violent, en matière de protection des civils et en matière de réconciliation », comme l’a si bien laissé entendre Anne Gueguen, ex représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations unies lors de la Réunion du Conseil de sécurité en format Arria – 24 avril 2018.
Toutefois, il est à noter que « la religion, de manière générale, a un rôle et une influence certaine au sein des groupes humains », écrit l’ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara dans une tribune publiée à Jeune Afrique. Aussi, vu la théorisation croissante de la religion, surtout l’islam comme facteur contributif à l’effectif des groupes armés terroristes, la responsabilité des leaders religieux dans la lutte contre l’extrémisme va s’avérer encore plus nécessaire et fondamentale.
A part l’État, auquel incombe en premier la responsabilité de protéger les populations, les leaders religieux peuvent également être considérés comme de « solides partenaires dans la prévention des atrocités criminelles et de leur incitation
D’une part, parce qu’ils jouissent d’une proximité avec tous les acteurs de la société civile. D’autre part, en raison de leur importance dans la gestion de la société, comme l’affirme Bakary Sambe, directeur régional de Timbuktu Institute. Ce dernier estimant qu’ils peuvent user de leur influence, de manière positive et négative dans la lutte contre l’extrémisme violent. Qu’ils sont en mesure d’« influencer avec certitude la vie et le comportement de ceux qui partagent les mêmes confessions et convictions religieuses qu’eux », renchérit le plan d’action des responsables et acteurs religieux de l’Onu.
« La religion fait partie de la solution et non du problème » ajoute Monsieur Douglas Johnston, président de l’International Conference on Research for Development (Icrd ). Il semble tout aussi crucial donc qu’à part l’État, auquel incombe en premier la responsabilité de protéger les populations, les leaders religieux peuvent également être considérés comme de « solides partenaires dans la prévention des atrocités criminelles et de leur incitation », lit-on également dans le plan d’action des responsables et acteurs religieux de l’Onu.
Le rôle des leaders religieux dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent passe donc par le dialogue, la promotion de la tolérance et d’une interprétation modérée des discours religieux, la médiation, la paix au sein de leurs différentes confessions religieuses. Pour faire simple, ils ont pour mission d’éduquer et « d’inculquer des valeurs de tolérance et de non-violence, d’acceptation et de respect mutuel, et en agissant pour faire baisser les tensions entre les communautés », souligne Monique Bourget membre de l’ordre religieux des sœurs de Sainte Marceline.
Une essence complexe
L’extrémisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest tire son essence du tréfonds de l’histoire, de la géographie, des philosophies de développement socio-politiques et économiques. Sa diffusion en effet, trouve un terreau fertile dans une région marquée historiquement par des déconvenues de la gouvernance politique, socio-économique et culturelle. Il se propage en se nourrissant des désillusions liées à un contexte certes, différent d’un pays à l’autre ou d’une région à une autre de pauvreté, d’insécurité, de corruption généralisée, de fortes inégalités régionales et d’analphabétisme. Une situation amplifiée par un sentiment d’abandon ou de « manque d’État », lui-même conforté par la nature de « souverain territorial de type archipélagique » des États du Sahel.
L’’’archipélisation’’ de l’État désigne « une juxtaposition d’îles de communication, c’est-à-dire des régions relativement dotées en voie de communication, par conséquent, des régions marquées par d’importants flux de personnes, d’idées et de biens ; à côté d’autres régions relativement peu dotées en infrastructures de même type, et qui se retrouvent pratiquement coupées du reste du pays » (Keutcheu, 2008, p.1-28). La construction archipélagique de l’État est un modèle de formation de l’État qui se caractérise par une plus grande présence et emprise de celui-ci dans certaines régions plus rapprochées du centre de décision au détriment de celles qui s’en éloignent. Ici, à mesure qu’on s’éloigne des capitales politique et économique, on est frappé par le sous-développement. Et la perception d’un « État vu de loin » dans les périphéries étatiques renforce les idéologies extrémistes dans leur tentative de subversion du vivre-ensemble.
Bien qu’il n’existe de consensus dans la classification des typologies des menaces sécuritaires, il est à reconnaître que la source des conflits en Afrique de l’Ouest est complexe et multiforme
L’extrémisme violent ou religieux est devenu plus factuel bien après la période post-indépendantiste en Afrique de l’Ouest. « Au sortir du système colonial, la paix et la stabilité constituaient deux des principaux enjeux auxquels les pays africains devaient faire face en raison de leur histoire politique et institutionnelle » nous renseigne Mamoudou Gazibo (Gazibo, 2010, P.117). Dans cet ordre d’idée, il affirme que la colonisation avait créé de nouveaux États, et donc redéfini les enjeux de pouvoir, réorienté les formes économiques et cristallisé de nouveaux intérêts.
Bien qu’il n’existe de consensus dans la classification des typologies des menaces sécuritaires, il est à reconnaître que la source des conflits en Afrique de l’Ouest est complexe et multiforme. D’ailleurs, la terminologie dite de l’extrémisme violent le prouve à suffisance. De plus, il est en mesure de prendre plusieurs formes y compris politique, économique, social, sectaire, national, linguistique, culturel ou religieux. Ici, il désigne toute doctrine non accommodante « dont les adeptes refusent toute modération ou toute alternative » contraire à leur philosophie. Aussi, ceux-ci dans une radicalité exacerbée, usent parfois de force ou de violence à l’encontre de tous ceux et celles ne partageant pas leur « vision du monde ». Mieux, l’extrémisme violent s’entend comme l’utilisation de la violence parallèle à un engagement idéologique visant des objectifs politiques, religieux, économiques ou sociaux. Par conséquent, selon, l’observatoire d’Alzahr il est « le fait de dépasser la limite proportionnelle de la modération. Il se diffère d’une société à l’autre conformément aux valeurs traditionnelles dominantes ».