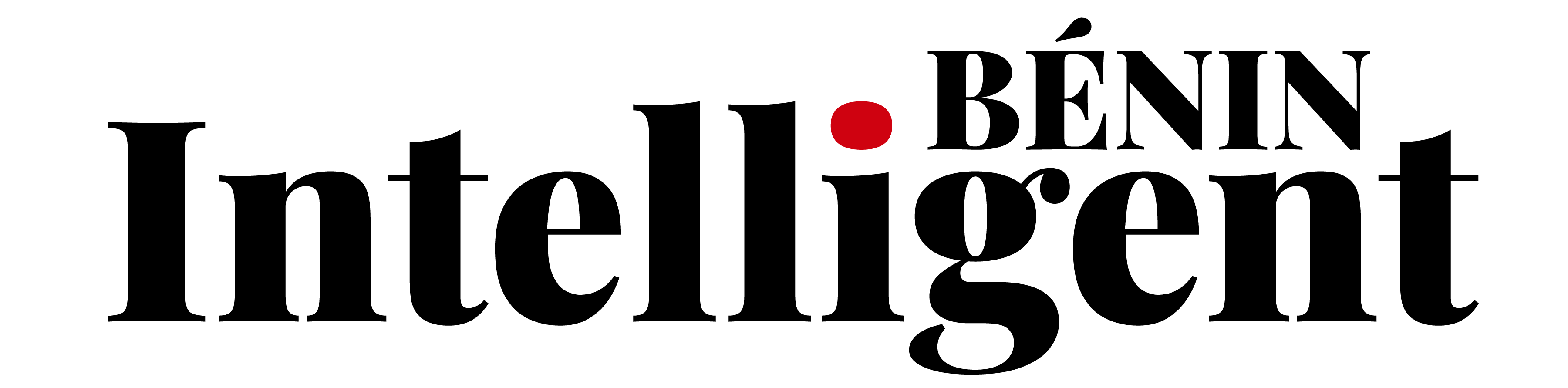Le 1er octobre 2024, l’Église Catholique a reconnu sa complicité dans les systèmes esclavagistes et colonialistes. Le Père Hermann Juste Nadohou-Awanou déconseille d’exiger des réparations économiques de l’Eglise. Il recommande aux victimes et leurs descendants le «pardon de Jésus». Hermann Nadohou-Awanou est par ailleurs Maître-Assistant des universités du CAMES en philosophie et enseignant d’anthropologie des religions à l’Université de Parakou. Il parle aussi des conséquences de ce mea culpa sur la perception de l’Eglise catholique en Afrique et les mouvements de retour aux sources.
Bénin Intelligent : L’esclavage a été aboli officiellement il y a plus de 170 ans (1848). La colonisation, elle, son glas date seulement des années 1960. Pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour que l’Eglise Catholique fasse son mea culpa ?
Père Hermann Juste Nadohou-Awanou : De tout temps, l’Eglise n’a jamais été absente des démarches pour l’abolition de l’esclavage et a toujours fait son mea culpa par rapport à l’esclavage et à la colonisation. Pour les plus récents, je vous le rappelle pour rendre justice à l’histoire ; puisque facilement, on colporte que l’Eglise a encouragé l’esclavage et la colonisation, et vous croyez qu’elle est plus coupable que les initiateurs de ces atteintes aux droits de l’Homme. C’est méconnaître l’histoire de l’Eglise et de l’Humanité dans ses hauteurs et ses bassesses que s’accrocher à ces propos.
Une condamnation solennelle récente de l’esclavage et du colonialisme par l’Eglise catholique a eu lieu au concile Vatican II avec la constitution pastorale Gaudium et Spes en 1965, qui évoque la dignité humaine et les atteintes aux droits de l’Homme. En 1992, le pape Saint Jean Paul II, lors de son voyage en République dominicaine, a humblement demandé pardon. Et lors de la préparation du Jubilé de l’an 2000, le même pape a écrit en 1994, dans Tertio millennio adveniente qu’
« il est donc juste que le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l’Eglise, prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l’esprit du Christ et de son Evangile, présentant au monde, non point le témoignage d’une vie, inspire par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d’agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignage et de scandale ».
Le mot est lâché : scandale et contre-témoignage. Et pour la demande de pardon, le cardinal Georges Cottier, théologien de la Maison Pontificale, précisait dans les Actes d’un Symposium international sur l’Inquisition en 1998, que l’Eglise ne souhaitait pas demander pardon de manière désordonnée :
« Le but du symposium qui s’est tenu du 29 au 31 octobre 1998 a été de caractère scientifique. Parce qu’une demande de pardon, que l’Eglise doit faire à propos de ses propres erreurs du passé, ne peut concerner que des faits authentiques et reconnus objectivement. On ne demande donc pas pardon pour des images répandues dans l’opinion publique, qui tiennent plus du mythe que de la réalité. »
Le 1er octobre 2024, dans le cadre de la poursuite du synode sur la synodalité et du jubilé de l’an 2025 en préparation et où tous les hommes sont invités à être pèlerins d’espérance, et suite aux divers voyages du pape François, où il a demandé pardon aux peuples visités (Bolivie, etc.) comme le pape Jean-Paul II, le Cardinal Michael Czerny, au nom du Pape François, déclarait :
« Nous n’avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l’exploitant – Je pense en particulier aux peuples indigènes – et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l’esclavage et le colonialisme ».
L’Eglise reconnaît qu’elle est complice. Il faut établir alors les niveaux de culpabilité. Jusqu’aux découvertes de Christophe Colomb, les papes étaient bien hostiles à l’esclavage, surtout à celui des baptisés, mais ils restaient impuissants tant ce phénomène était nécessaire à la vie économique de leur époque.
Et les fantasmes sous-jacents pour justifier tant l’esclavage des Noirs que la colonisation étaient : l’utilité publique, la gloire du roi, la propagation de la foi, le salut des âmes, auxquelles venaient s’ajouter l’infériorité naturelle des Noirs par rapport aux Blancs, et leur barbarie ou l’image du Noir porteur du démon.
Solórzano Pereyra, auteur de Política Indiana, expliquait qu’ « à la suite de la diminution des Indiens, les trésors qu’offrait l’Amérique ne pouvaient rester sans exploitation ; que dès lors, pour le confort et le profit des maîtres, les Noirs devaient prendre la relève et pouvaient être traités comme de simples bêtes de somme, traitement qui, du reste, était moins inhumain que celui que recevaient les esclaves en terre musulmane dans l’extraction des minéraux ».
Jusqu’à ce que l’Eglise reconnaisse qu’elle a cautionné, du moins qu’elle a été complice, c’est qu’elle a vu des choses et n’a pas agi contre ; ou encore qu’elle a collaboré avec le colonisateur ou l’esclavagiste, car être complice, c’est voir et ne pas agir contre ; ou encore, voir et collaborer à cela. A quel niveau, l’Eglise a-t-elle été complice ?
On me citera le texte du bref Divino amore communiti, délivré le 16 juin 1452 par le pape Nicolas V à Alphonse V de Portugal, cité par Daniel Rops (1955, p. 314), dans l’ouvrage L’Église de la Renaissance et de la Réforme. Une ère de renouveau : la Réforme catholique, publié aux éditions Fayard à Paris :
« Les royaumes, duchés, comtés, principautés, et autres domaines, terres, lieux, camps, en possession des susdits Sarrasins, païens, infidèles et ennemis du Christ […] par l’autorité apostolique, nous vous conférons la pleine et libre faculté de les envahir, conquérir, emporter et subjuguer, et de réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitant ».
On peut aussi me citer les faits relatés par les œuvres de Ferdinand Oyono, Une vie de boy, et Le Vieux Nègre et la Médaille, où des valeurs prônées par l’Eglise catholique comme l’amour, le pardon et la justice ont été foulées au pied, et où des membres de l’Eglise ont apporté de l’aide soutenue au colonisateur, garantissant ses entreprises et lui offrant bonne honnêteté, bénéficiant des moyens logistiques et financiers des colonisateurs pour se déplacer à l’intérieur des colonies, mais il faut reconnaître que c’est deux logiques différentes, qui se côtoyaient, ou se tutoyaient à la limite.
Le colon était dans la logique de Jules Ferry, porte-parole de la gauche républicaine, qui pense que “les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures” (Déclaration du 28 juillet 1885 devant les députés), tandis que le missionnaire était dans la logique du Christ “Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les…” (Mathieu 28, 19-20). L’action du missionnaire n’est donc pas une rallonge de l’action coloniale.
Il me plaît de rappeler le souvenir de ce prêtre béninois, anthropologue et théologien de grande classe et de vénérée mémoire, le Père Alphonse Quenum, qui avait publié un livre de 341 pages dans ce sens, en 1993, aux éditions Karthala à Paris, Les Eglises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle.
Dans ce livre d’enquête, il s’est livré à une longue interrogation qui n’a pas trouvé de réponse historique claire et définitive sur le lourd et pesant silence de l’Eglise sur les mauvais traitements subis par les Indiens au moment de la découverte de l’Amérique et l’abomination de la traite négrière, que dénonçaient des individus et des ordres religieux, tels que les Capucins, qui ont été les premiers à évangéliser la Côte du Bénin avant les Pères de la Société des missions africaines (Sma).
Ce qui montre que la bonne conscience n’était pas si massive à l’époque. Elle devrait être noyée dans la longue prévalence de la théorie aristotélicienne sur l’esclavage, plus généralement la reconduction des vieilles références héritées de l’Antiquité esclavagiste sans compter sur l’idée de la plupart des théologiens, pour qui la traite des esclaves était un moindre mal, puisque elle permettait aux païens de connaître la véritable foi. Dans les Antilles, certains hommes d’Eglise ont voulu limiter les dégâts de l’intérieur en essayant d’adoucir la condition des esclaves face à la lenteur des prises de position des papes.
Chaque époque a connu son lot d’esclavages. Les Hébreux ont été longtemps esclaves des Egyptiens. L’esclavage a été aboli en 1848 par Victor Schoelcher, enseigne-t-on. Mais n’oublions pas tout le background qui a préparé cette abolition officielle. Arrière-fonds dans lequel on retrouve les combats des papes Eugène IV en 1435, Paul III en 1537, Urbain VIII en 1639, Benoît XIV en 1741, Pie VII en 1814, et Grégoire XVI en 1839, soit 9 ans avant l’abolition du phénomène par Victor Schoelcher. Les papes, qui donc ont réagi contre ce phénomène de l’esclavage sont plus nombreux que ceux qui l’ont cautionné.
Pouvez-vous nous parler du combat de ces papes, pour éclairer la lanterne de l’opinion publique ?
Volontiers. En 1435, le pape Eugène IV a publié l’encyclique Sicut dudum (en français, Il n’y a pas longtemps…) et y a condamné l’esclavage des indigènes et autochtones des Îles Canaries.
En 1537, le pape Paul III a interdit l’esclavage des Amérindiens et de tout autre peuple qui viendrait à être découvert.
De même, le pape Pie VII, en 1814, conduit par le même esprit de religion et de charité que ses prédécesseurs, a pris soin d’interposer ses bons offices auprès de puissants personnages pour que la traite des Nègres cessât enfin tout à fait parmi les chrétiens.
Le 3 décembre 1839, soit 9 ans avant l’abolition de la traite négrière, le pape Grégoire XVI a publié la bulle In supreme apostolatus (en français, Placé au sommet de l’apostolat, Pour détourner du commerce des Noirs), réaffirmant les positions de son lointain prédécesseur Paul III sur l’esclavage pour appliquer à détourner tout à fait les fidèles du commerce inhumain des Nègres ou de toute autre espèce d’hommes, à un moment où la domination portugaise s’est étendue sur la Guinée, pays des Nègres.
On parle plus de Victor Schoelcher, mais on ne parle pas du combat de ces papes. On n’est plus prompt à parler de complicité des papes, mais on néglige la complicité des rois africains et des négriers noirs, qui jouissaient des fruits de ce commerce devenu illicite. L’Eglise catholique, sensible pour la cause de l’homme, mieux que quelque institution, a toujours pris fait et cause pour les esclaves depuis ses commencements.
On peut lire à cet effet, la lettre de saint Paul à Philémon, qui évoque le cas de l’esclave fugitif Onésime. Et plus tard toute la vie de l’esclave soudanaise Bakhita Joséphine, devenue sainte. C’est donc dire l’Eglise, experte en humanité, prend à son compte les préoccupations des esclaves en accordant un droit d’asile à l’esclave en fuite, parce que Jésus, lui-même, a pris rang d’esclave (Philippiens 2, 7-8), en lavant les pieds de ses disciples (Jean 13, 1-7), comme cela se faisait par les esclaves, dans la tradition juive. L’Eglise protège toujours les malheureux et se propose comme l’asile sûr des esclaves maltraités.
Quelles pourraient être les conséquences de la demande du pardon sur la perception/crédibilité de l’Église Catholique désormais en Afrique ?
Si l’Eglise en était encore à plaire à des hommes, elle ne serait pas servante du Christ, comme pour paraphraser saint Paul en Galates 1, 10. L’Eglise ne cherche pas la perception humaine, ni le regard des hommes sur ses bonnes œuvres, surtout quand ses œuvres suivent la logique divine d’éviter le scandale.
L’Eglise recherche trois choses en posant cet acte, d’abord la guérison des cœurs et des mémoires, ensuite le pardon, et enfin que son exemple serve d’école à l’humanité colonialiste et esclavagiste. Le colonialisme persiste dans le monde. Les formes d’esclavage subsistent encore dans le monde. La guérison de la mémoire est nécessaire parce que la mémoire de la souffrance répète la souffrance. Cette guérison passe par le pardon.
Miroslav Volf (2006 : 9) avait déjà fait ce constat que beaucoup de victimes croient qu’elles n’ont pas d’obligation à pardonner et à se réconcilier avec l’abuseur, elles ne réalisent pas l’humanité, mais la trahissent plutôt. Or le pardon est une dimension constitutive de toute histoire humaine. Demander pardon est un acte qui plonge les parties en cause dans la paix et dans la confiance en l’avenir. Pardonner n’est donc pas une faiblesse. Hannah Arendt, une philosophe juive, dans Condition de l’homme moderne, pense que le message le plus innovant de Jésus est le pardon comme solution des conflits. Ceux qui pardonnent et ceux qui sont pardonnés sont ensemble réintégrés dans la communauté des croyants.
En admettant sa complicité dans ces crimes qui continuent de nourrir des frustrations en Afrique, l’Église ne craint-elle pas un recul de la foi chez les fidèles catholiques affectés par cette histoire ?
Pas du tout. Loin de là. Admettre sa complicité n’exclut pas que le vrai fautif soit recherché et pris en considération. Le vrai fautif, c’est l’initiateur de l’esclavage et du colonialisme. Puis vient le complice. Ce qui se joue-là de façon à peine perceptible, c’est que les esclavagistes et les colons seront assez myopes pour comprendre qu’il faut suivre l’étoile de l’exemple de l’Eglise, pour que plus jamais, pareilles situations sociales et humaines n’adviennent dans le monde.
L’Eglise se pose donc et pose les victimes à qui elles demandent pardon en position de pèlerins d’espérance et en artisans d’amour. Ces victimes n’auront pas besoin d’attendre que les colons et les esclavagistes viennent à eux pour demander pardon, avant de pardonner. C’est donc dans un rôle avant-gardiste de justice sociale que se retrouve l’Eglise.
Alors ce qu’on peut espérer, c’est un regain de foi, pour un mieux vivre-ensemble. Les victimes, en se sentant considérées, vont intégrer la foi et vivre une charité parfaite. C’est une prise de responsabilité collective pour une nouvelle mission en vue du vivre-ensemble qui se profile à l’horizon.
Est-on désormais en droit d’exiger des réparations (surtout économiques) de l’Église Catholique sur la base de cette reconnaissance ? Ou comment peut-elle corriger alors ses torts historiques ?
Il est vrai que l’Eglise anglicane a créé récemment un fonds d’excuses pour réparation de l’esclavage. Mais ne fait-elle pas, là, fausse route, pour que l’Eglise catholique puisse la suivre ? Si l’on exige des réparations économiques, ce ne sera que forfaitaire, parce qu’aucun instrument de réparation n’a été encore inventé par les hommes pour exiger et situer des réparations justes.
Et avant même que cette réparation ne soit exigée, il faudra situer toutes les responsabilités sans en omettre une. Les Etats esclavagistes et colonialistes sont les premiers responsables. Les rois africains et leurs collaborateurs sont aussi responsables de l’esclavage. Du point de vue de la colonisation, ceux parmi les rois africains, qui ont fait foi à des traités, ont plus leur part de responsabilité, que ceux qui ont lutté jusqu’au sang. Tous ceux-là doivent payer et réparer, quand les responsabilités seront situées, avant que l’Eglise, si elle ne devrait payer, ne paie que pour son silence ou son inaction.
Et pour éviter tout cet amalgame et éviter de perdre du temps pour avancer, il faut entrer dans la logique du pardon du Christ. Le pardon, selon les vues du Christ, c’est renoncer à riposter. Ce qui change avec Jésus, c’est que le travail du pardon passe de l’offensé à l’offenseur. Autant l’offenseur prouve son repentir par la réparation du tort qu’il a fait subir, autant l’offensé devra renoncer à exiger réparation. Car l’offense est comme une dette contractée par l’offenseur. Il a fait du tort, donc il doit réparer. L’offensé est en droit d’exiger réparation comme condition à son pardon.
Dans le pardon, tel que Jésus le conçoit, l’offensé renonce à exercer ce droit de réparation ; il libère l’offenseur du repentir préalable. Le pardon est donc le seul moyen pour stopper la spirale de la violence et des mauvais souvenirs qui infestent la mémoire. Le pardon pousse à passer de l’énergie diabolique (celle qui sépare) à l’énergie symbolique (celle qui rassemble).
On parle depuis de néocolonialisme et même d”’esclavage moderne”. L’Église est-elle toujours coupable de la rémanence de ces crimes dont elle s’excuse aujourd’hui ?
Non, l’Eglise n’est pas toujours coupable de la rémanence de ces crimes dont elle s’excuse aujourd’hui, et n’en sera pas. Elle regrette ce qui s’est passé et compte sur le secours de la sainte grâce de Dieu pour ne plus récidiver. C’est vrai que certaines religions se posent aujourd’hui de plus en plus en outils du néocolonialisme en Afrique. Mais pas l’Eglise catholique d’Afrique, plus que jamais enracinée dans les cultures, qui vit dans la fidélité au message du Christ. Vous avez encore en écho le “non” retentissant des évêques africains à la bénédiction des couples homosexuels.
Le néo-colonialisme que vous relevez s’accompagne de l’expansionnisme des Eglises évangéliques en Afrique, qui a de solides connexions avec le milieu politique américain et qui semble rivaliser d’ardeur et d’ingéniosité avec la fraternité islamique soutenue par les pays du Golf. Tout le monde sait que les lobbies évangélistes influencent de plus en plus la politique intérieure et extérieure des Etats-Unis. On n’est pas étonné de l’extrême indulgence des autorités américaines à l’égard de certains régimes qui n’ont cure des droits humains. L’Afrique est plus une terre d’investissements pour les pays du Golf qu’une terre dont les mines sont à exploiter comme le pensent les Occidentaux.
La déclaration de l’Église catholique peut-elle alimenter davantage le réveil panafricaniste anti-Occident et revigorer les actes de ”retour aux sources” ? Ou pensez-vous l’effet contraire ?
Normalement non. C’est vrai qu’on observe sur le continent africain, que de nombreux inconditionnels des mouvements de “retour aux sources africaines” affichent une hostilité flagrante et radicale vis-à-vis du christianisme, qu’il considère comme une religion importée aux antipodes des réalités et de l’identité africaine. Aujourd’hui, certains font penser que le panafricanisme, c’est rester à longueur de journée à invectiver l’autre, comme s’il nous empêche d’être ce que nous sommes.
Aujourd’hui, ce qu’on constate, des soi-disants panafricanistes, vont chercher leur pitance auprès des puissances coloniales extérieures pour venir invectiver d’autres puissances coloniales. Il leur aura manqué de comprendre comment l’enseignement du Christ aide à mieux apprécier ses us et coutumes pour être pleinement panafricaniste et entièrement chrétien, puisque le Jésus historique était lui aussi un jeune attentif, compatissant à la souffrance de son peuple, soucieux de la chose publique et qui a courageusement affronté ceux qui étaient à la base de la souffrance de son peuple.
Le vrai panafricanisme est soucieux du respect de l’autre par la justice et la charité prônées. L’idéal panafricain a toujours été que l’Africain s’imprègne de son passé, pour comprendre les réalités et les obstacles présents qui se posent à lui, pour envisager les grandes lignes du combat panafricain pour un avenir meilleur. Comme tel, le panafricanisme rejoint l’engagement chrétien pour un monde plus juste et libéré de tout asservissement au mal. Le panafricanisme, pour être mieux inspiré, doit alors se laisser illuminer par la dynamique de l’inculturation. Le panafricanisme n’est donc pas en soi une doctrine anti-religieuse et anti-chrétienne. Joseph Ki-Zerbo, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Patrice Lumumba et Julius Nyerere et d’autres grands panafricanistes ont pu concilier les deux.
Sur la question de la restitution du patrimoine culturel pillé, autre corollaire de la colonisation. Les SMA détiennent aussi par exemple de nombreuses œuvres culturelles/cultuelles du Bénin en France. Pourquoi l’Église reste silencieuse sur cette question ?
Vous parlez de patrimoine culturel pillé et que l’Eglise devra en parler. Cela sort du mandat reçu du Christ par l’Eglise. Et si c’était vrai, c’est faire de la publicité au mal. Il y a des démarches diplomatiques plus idoines. Les missionnaires pilleraient, qu’ils seraient sortis de leur rôle. On peut retrouver, dans leur coffre, des objets d’arts qu’ils ont achetés ou que des communautés leur ont offerts.
Ce que vous dites des Pères des Sociétés des Missions Africaines (SMA), je ne peux ni le confirmer, ni l’infirmer. Mais je peux vous dire, même je suis prêtre diocésain, que je suis un pur produit des Pères de la Société des Missions Africaines, les Pères Bellut Denis, Germain Flouret et Jacques Lalande, qui m’ont envoyé au séminaire à Calavi.
J’ai eu la grâce de côtoyer et de travailler avec pleins de missionnaires SMA français, René Grosseau, André Chauvin, et des missionnaires SMA Béninois, Nigérians, Ghanéens, Togolais, Ivoiriens, Centrafricains, Indiens.
Et à l’heure actuelle, je peux vous dire que s’il y a des Béninois dans cette société de vie apostolique et que des œuvres culturelles du Bénin sont là, ces œuvres sont donc en grande sécurité. Quand vous parlez d’œuvres cultuelles, je me pose la question-ci : Ils vont en faire quoi ? N’exagérons pas tout de même, pour voir des œuvres cultuelles où l’on peut voir des œuvres culturelles.