Dans cette tribune, Raouf Affagnon interroge la frénésie des gouvernements africains à développer des IA dans tous les domaines notamment le secteur de l’éducation. Le superviseur de centre de correction et de délibération du Bac met en garde contre «le sacrifice de la main d’œuvre qualifiée, sur l’autel de la technopédagogie et du profit immédiat.»
Introduction
“Les rapports de force donnent à l’absence le pouvoir de détruire la présence”, Simone WEIL
Le samedi 12 avril 2025, j’ai retrouvé sur deux forums du secteur de l’éducation, un message qui véhicule des informations à caractère pédagogique et politique. Le texte est intitulé : l’IA (Intelligence Artificielle) au service de la correction de l’examen d’Etat 2025, en RDC, avec un accent particulier sur l’idée de remercier les correcteurs humains.
Pour le lancement de la réforme, le centre de correction de l’Examen d’Etat (EXETAT) a été inauguré à Kinshasa, sous la conduite de la Ministre d’Etat de l’Education Nationale, son Excellence Raïssa MALU, accompagnée du Vice-Ministre Jean-Pierre KEZAMUDRU. Avant de lire le texte, les premières questions qui me sont venues à l’esprit sont les suivantes : en quoi l’IA peut-elle être utile, dans le domaine des travaux de correction des examens nationaux ? Qui a inventé l’IA ? L’homme ou la nature ? L’IA peut-elle être supérieure à l’intelligence humaine ?
Après la lecture du document, j’étais plongé dans la perplexité. Mon silence serait un silence complice, couard et coupable.
I- Quelques aspects suspects et mensongers de la réforme de la correction de l’examen d’Etat 2025, en RDC
Suite à la lecture du texte, plus d’une fois, j’étais perplexe, pour plusieurs raisons.
La première raison est le caractère anonyme du texte. Comment peut-on expliquer le choix des autorités politiques de la République Démocratique du Congo de publier le compte rendu d’une grande cérémonie comme le lancement d’une réforme pédagogique de cette ampleur, tout en cachant le nom de l’auteur ?
La deuxième raison est le caractère incomplet de la date de l’inauguration du centre de correction de l’examen d’Etat (EXETAT) à Kinshasa. Quel a été le degré de la précipitation avec laquelle le compte-rendu a été rédigé, afin que la date n’affiche ni le mois de l’année, ni le jeudi dont il s’agit. Il a été signalé que « le centre a été inauguré jeudi 2025 » ? Laquelle des langues nationales du Congo recommande l’usage de cette syntaxe ? Le Lingala, le Kikongo ou le Swahili ?
La troisième raison est l’affirmation gratuite, pour ne pas dire mensongère, qui s’est glissée dans le compte rendu et qui rapporte que « le logiciel intelligent, développé en partenariat avec les experts internationaux en éducation et en technologie, utilise des algorithmes, capables de détecter des similitudes suspectes, entre les copies ». Nos frères et sœurs du Congo Kinshasa ont oublié qu’il s’agit là des IA génératives qui doivent être rigoureusement encadrées, notamment pour éviter le plagiat et la désinformation.
La quatrième raison touche l’un des objectifs de la réforme qui est de réduire le temps de correction de 60%.
Tout porte à croire que la réforme est, à la fois, une course de vitesse et de fond, oubliant que les travaux de la docimologie incitent, pour une amélioration des pratiques d’évaluation, à la modestie et à la modération, avec un esprit d’équipe.
La cinquième et dernière raison se réfère au projet de généralisation de l’utilisation de la technologie, dans « tous les centres du pays », en 2026, après l’expérimentation en 2025. Ce projet montre clairement que les autorités congolaises de l’éducation sont fortement atteintes d’une boulimie pour l’utilisation de l’intelligence artificielle, au point où elles se voient dans l’obligation d’escamoter une étape très importante entre l’expérimentation et la généralisation qu’est l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme.
II- Quelques aspects de la pratique de l’évaluation des examens nationaux au Bénin
Depuis le début des années 2000, la pratique de l’évaluation des examens nationaux au Bénin est basée sur les programmes d’études, selon l’Approche Par Compétences.
Les acteurs désignés pour cette mission républicaine sont les enseignants. A ce sujet, la loi de novembre 2003, portant Orientation de l’Education Nationale en République du Bénin, en son article 63, stipule que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires et universitaires des élèves et des étudiants. Ils en assurent le suivi et l’évaluation au sein d’équipes pédagogiques ». Du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) au Baccalauréat, en passant par le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), les consignes répétées chaque année, sont les suivantes :
1. les copies des candidats doivent être corrigées sous anonymat et la valeur de la production de chaque candidat est exprimée par une note variant entre zéro(o) et vingt (20) ;
2. une correction critériée ne peut que permettre de donner aux candidats des notes plus justes ;
3. une grille de correction reste un outil d’appréciation des critères, indispensable pour le travail des évaluateurs ;
4. chaque correcteur est tenu d’effectuer une application correcte et non mécanique de la clé de correction et du barème, sous la supervision d’un contrôleur ;
5. chaque contrôleur a l’obligation de superviser les travaux d’un maximum de cinq (05) correcteurs ;
6.tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, est puni ipso facto, par une exclusion, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur ;
7. les correcteurs, tout comme les contrôleurs, ont l’obligation morale d’apprécier les copies des candidats, avec le plus grand professionnalisme qui soit ;
8. les travaux de correction des copies du CEP et du BEPC ne durent pas plus que cinq jours ; pour le Bac, ils durent six jours, au maximum ;
9. NB. Les trois paramètres qui participent à la validation du Baccalauréat Béninois sont la permutation des copies des candidats, entre les centres de corrections et de délibérations, avant la phase de la correction desdites copies, l’organisation de trois délibérations (deux au premier groupe et une au deuxième groupe) et la possibilité donnée aux candidats de contester la note à eux attribuée, dans une ou plusieurs matières de composition. Cette disposition qui autorise une consultation des copies par les candidats qui le souhaitent, oblige les évaluateurs commis à la tâche, à beaucoup plus de rigueur et de responsabilité, comparativement aux évaluateurs du CEP et du BEPC.
III- De quoi se mêle l’IA, en matière de correction des examens nationaux ?
L’évaluation des acquis des apprenants à un examen est une activité fondamentale, dans tout système de formation. Quels que soient la conscience professionnelle et le désir de bien faire de l’enseignant-correcteur, quelle que soit la matière qu’il enseigne, cette activité lui donne du fil à retordre. Pour améliorer sa pratique de l’évaluation, il doit s’éloigner de la pratique solitaire et rejoindre un groupe de travail doté de correcteurs, de contrôleurs et de superviseurs outillés pour la mission. Dans ce cas, il y a lieu de se demander de quoi se mêle l’IA.
Selon le Petit Larousse illustré, édition 2025, « l’IA est une discipline scientifique et technique, née au milieu des années 1950, qui a pour objet de mettre au point des machines capables d’imiter l’intelligence humaine ». La Littérature enseigne qu’il y a deux types d’IA. Il y a l’IA dite “faible”, basée sur des algorithmes de recommandations (publicités), etc et l’IA dite “forte”, capable d’avoir conscience de soi et de prendre des décisions de manière autonome, qui n’existe pas encore et poserait des problèmes légaux.
Si le développement de l’IA est encore à ce niveau, quel prix voulons-nous gagner, en nous livrant à une course effrénée, en vue de l’utilisation d’une intelligence produite par une technique humaine et non par la nature ? D’une manière ou d’une autre, l’homme qui est le créateur de l’IA est mieux placé que quiconque pour décider du type de mission qu’il peut lui confier et le type de mission qu’il doit effectuer lui-même.
Conclusion
Les discours vantant les prétendues capacités de l’IA sont devenus courants, pour ne pas dire omniprésents. Dans les pays africains, une compétition s’observe, pour ce qui concerne l’installation de l’IA dans tous les domaines.
L’objectif visé par la réforme de la correction des examens nationaux est le sacrifice de la main d’œuvre qualifiée, sur l’autel de la technopédagogie et du profit immédiat.
Autrement dit, nous vivons dans des sociétés obsédées par le développement économique et technologique, sans aucun égard pour le respect de ce qui fait l’humain, le commun, la nature, la vie en général. Cette obsession pousse à instaurer le règne de la machine et à coloniser même nos institutions scolaires et universitaires, un des lieux principaux qui assuraient la production et la reproduction de la société. Les pouvoirs publics mettent en place les conditions pour une destruction de la présence humaine en un lieu et en un temps donné, de la culture, dont Aimé Césaire disait qu’elle était « tout ce que l’homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable ».
En coupant la racine des rapports sociaux, qui impliquent empathie, réciprocité et solidarité, non seulement on détruit les possibilités de manifestation, de revendication et de révolte, mais également on ouvre la voie au totalitarisme systémique. C’est vrai, l’IA peut aider l’homme, son créateur, à résoudre des problèmes sociaux comme la correction des items basés sur les questions à choix multiples. Mais, sans être un technophobe, je parie que corriger une épreuve de commentaire ou de dissertation serait de la mer à boire pour l’IA.
Au total, dans le contexte actuel des examens de fin d’année, la prise en compte de l’apport critique de la docimologie et le recours à la correction critériée, la pierre angulaire de l’évaluation des compétences par un groupe d’évaluateurs professionnels, sont les meilleures démarches pour combattre efficacement le fléau des réussites et des succès abusifs. Depuis plus de dix ans, l’organisation et le déroulement du Baccalauréat au Bénin sont devenus des pratiques labélisées, dans l’espace UEMOA. Tous les pays francophones gagneraient à s’aligner sur ce modèle, qui s’améliore d’année en année, dans le domaine de l’évaluation des acquis des candidats, lors des examens de fin d’année.
Par M. Raouf AFFAGNON,
Superviseur de centre de correction et de délibération du Bac,
Ancien acteur du programme Fulbright d’Echanges d’Enseignants, programme créé par les Etats-Unis

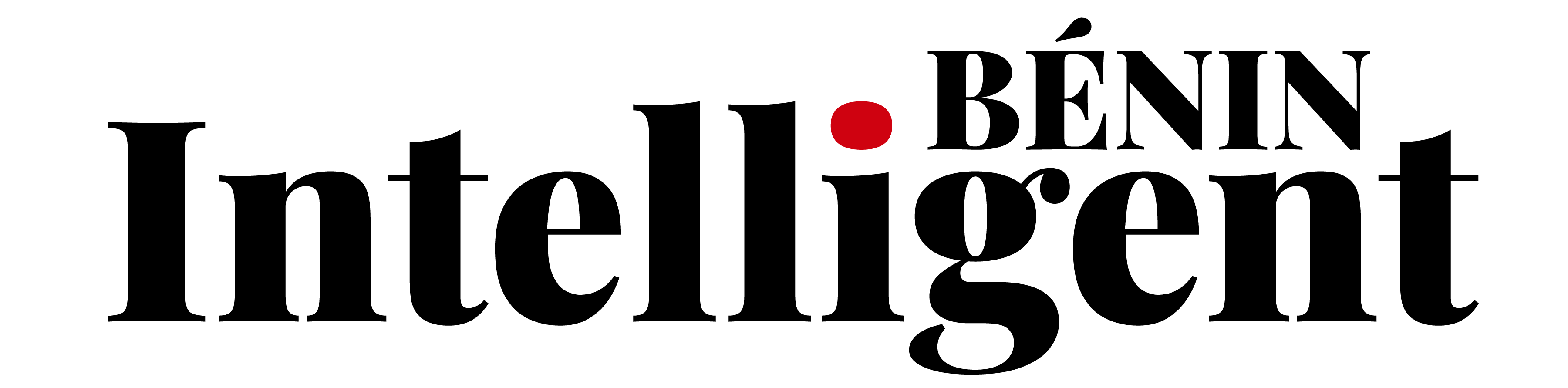




1 Commentaire
Merci