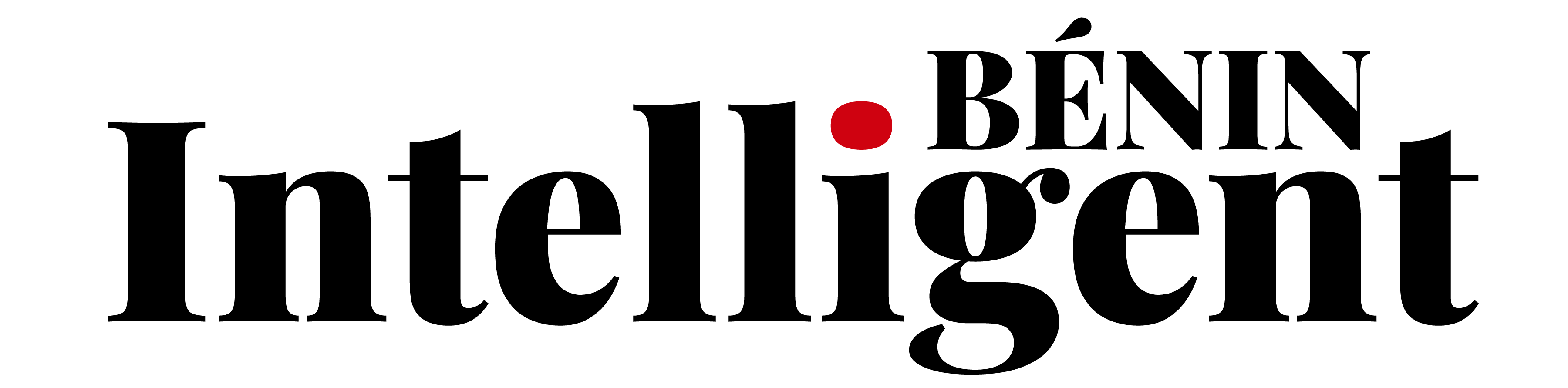Le président de la Transition malienne, Assimi Goïta a promulgué samedi 22 juillet par décret n°2023-041/PT-RM la nouvelle constitution ; cet acte marque l’avènement de la quatrième République. La nouvelle Loi fondamentale du Mali, qui remplace celle de 1992, était au cœur du référendum constitutionnel contesté du dimanche 18 juin d’où le « Oui » est sorti vainqueur à 97%.
Par Sêmèvo Bonaventure AGBON
Le texte publié au journal officiel spécial n°13, renforce les pouvoirs du président de la République. Selon l’article 44, il « détermine la politique de la nation » désormais, une prérogative jadis dévolue au gouvernement.
Le gouvernement n’est plus responsable devant l’Assemblée nationale mais plutôt devant le président. « On passe d’un régime semi-présidentiel à présidentiel », commente à Tv5 Monde le professeur Brema Ely Dicko de l’université de Bamako.
Le chef de l’Etat est élu pour un mandat de cinq ans, au suffrage universel direct (article 45). Il ne peut exercer plus de deux mandats. En son article 45, la nouvelle constitution interdit le cumule de nationalité : « …doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité, à la date de dépôt de la candidature » ; l’âge requis est compris entre 35 ans, au moins, et 75 ans au plus.
Au chapitre II, le principe de la laïcité de l’Etat malien est consacré ; c’est le point qui a fait le plus objet de polémique lors du référendum. « La laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et de conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle », rassure le texte en son article 22.
La nouvelle constitution fait passer le nombre d’institutions de la République à 7 (article 36): président de la République, gouvernement, parlement, cour suprême, cour constitutionnelle, cour des comptes et conseil économique, social, environnemental et culturel.
Tout comme le Bénin qui a reconnu la chefferie traditionnelle lors de la révision de novembre 2019, le Mali constitutionnalise aussi les « autorités et légitimités traditionnelles » (Titre VIII). Celles-ci sont « gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits », précise l’article 179.
L’alinéa suivant laisse le soin à la loi de déterminer « les différentes catégories d’autorités et de légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur intervention ».
Dans le pays sahélien, ces autorités avaient de l’influence mais elles « ont beaucoup perdu avec l’avènement de la démocratie », reconnaît un chercheur malien sous anonymat à Tv5 Monde.
« Le recul de l’Etat a fait que les religieux, les autorités coutumières, ont de nouvelles fonctions de distribution de la justice. Quand ces choses se pratiquent et durent dans le temps, il faut penser à une institutionnalisation », souligne le Dr Abdoul Sogodogo au même média français.
Unité africaine et langues officielles
Au titre IX, le Mali réaffirme sa foi en l’unité africaine. « La République du Mali peut conclure, avec tout Etat africain, des accords d’association ou d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine » (article 180).
Le nouveau texte condamne les coups d’Etat. « Tout coup d’État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien », lit-on à l’article 187. Toutefois, elle fait table rase du passé. « Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution, couverts par des lois d’amnistie, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement. » (article 188).
Rejoignez-nous sur Telegram pour plus d’entretiens, reportages et analyses exclusifs
Le français perd son statut de langue officielle et devient langue de travail. Les langues nationales du Mali acquièrent, elles, le statut de langues officielles. « L’Etat peut adopter toute autre langue comme langue de travail » (article 31). La nouvelle Loi fondamentale maintient la législation en vigueur mais abroge de façon expresse toutes dispositions à elle contraire (article 189).
Enfin, le constituant originaire exclut du champ de révision, la forme républicaine de l’Etat, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme. (article 185, alinéa 2).
LIRE AUSSI: Régis Hounkpè : « Le Mali a besoin de la couverture institutionnelle et politique de la Minusma »
LIRE AUSSI: Sécurité en Afrique de l’Ouest : Barkhane se retire mais ne part pas