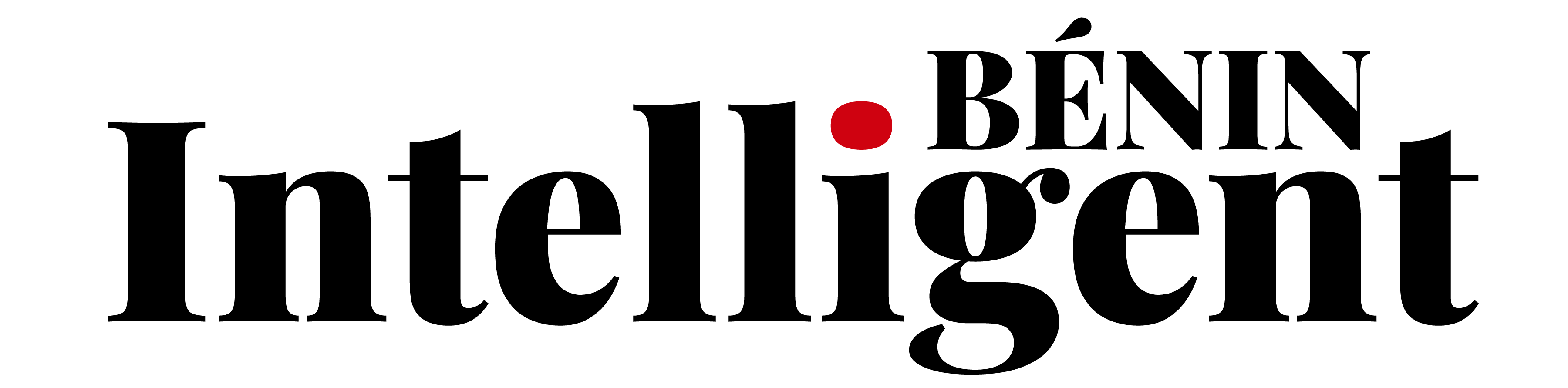La gestion du terrorisme en Côte d’Ivoire suscite reflexion. En Afrique de l’Ouest, les approches de solution varient d’un pays à un autre. Toutefois, il y a à révéler que la gestion du terrorisme en Côte d’Ivoire est singulière. Jean-Marc Kouamé refute cet argumentaire. Parce que pour lui, « l’avantage de la Côte d’Ivoire, comme d’autres pays du Golfe de Guinée, réside dans le fait qu’ils ont pu observer l’expansion du phénomène extrémiste chez leurs voisins » accrédite le Coordonnateur de WANEP-Côte d’Ivoire. À travers cet entretien, sur la gestion du terrorisme en Côte d’Ivoire, l’interviewer livre sa lecture de l’impact de la nouvelle dynamique politique régionale en matière de sécurité.
Bénin Intelligent : L’avènement de l’Alliance des États du Sahel a remodelé les dynamiques sécuritaires des pays de la Cedeao. Comment évaluez-vous, à cet égard, l’impact de ce nouveau paradigme sur la sécurité régionale ?
Jean-Marc Kouamé : Alors, il faut dire que la création de l’Alliance des États du Sahel vient redéfinir un peu la cartographie sous-régionale en matière de puissance et de commission inter-États. Nous avions la Cedeao, l’Uemoa ainsi que d’autres entités sous-régionales qui s’entraident pour organiser la vie socio-économique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, l’apparition de l’AES vient révéler une forme de dissociation de ces entités existantes. Ou finalement un aveu d’échec de ces dernières. Notamment de la Cedeao dans sa mission de garantir une stabilité dans ses États-membres. Cela s’explique par plusieurs faits.
En effet, on peut brandir, par exemple, la résurgence ou la difficulté à contenir les incursions extrémistes et terroristes dans certaines zones. À tel point que des pays de la zone côtière sont touchés, à savoir le nord de la Côte d’Ivoire, le Togo, et le Bénin. Aussi, il y a des incursions que l’on a pu constater dans d’autres pays, comme à la frontière Mali-Sénégal. Ce que je peux rajouter, à ce niveau, c’est qu’il faut analyser déjà les initiatives de maintien de l’ordre et sécuritaires. En général, tout ce qui a été mené comme actions dans ces zones et leurs localités. Puis évaluer leurs impacts. Nous avons eu le G5 Sahel, la force Barkhane, Takuba ainsi que d’autres initiatives. Même la Cedeao a tenté d’y déployer des soldats.
La création de l’AES peut ne pas représenter une mauvaise chose
Si actuellement nous peinons encore à contrer le phénomène, c’est bien que dans leur mode de fonctionnement (Cedeao et les initiatives régionales) ou dans leur ancrage au sein des communautés, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a aussi le contexte socio-politique. Qui est marqué par une certaine crise économique dans ces pays-là et des revendications sociales importantes. Si bien que des régimes militaires ont été soutenus par l’opinion populaire, en quelque sorte. Dans ces zones, il y avait aussi un renforcement du sentiment anti-occident. Sinon anti-français, qui a soutenu un peu la propagande pour l’installation des régimes militaires dans ces différents pays qui constituent l’Aes.
La tendance aujourd’hui est qu’il faut toujours privilégier le dialogue et les échanges afin de trouver la meilleure solution. En soi, la création de l’AES peut ne pas représenter une mauvaise chose. Dans la mesure où elle peut permettre de créer une nouvelle dynamique de gouvernance. Nonobstant, étant vraiment attaché aux valeurs démocratiques, ce que nous prônons est qu’il faille quand même chercher à obtenir le consensus pour rétablir un État de droit. Il en est de même en ce qui concerne le fait de relancer la machine sécuritaire. Afin que les menaces transfrontalières telles que le terrorisme, dans les différents États concernés, puissent agir main dans la main.
Face à cette impasse géopolitique et sécuritaire, quel doit être la posture de la jeunesse et des associations de la société civile ?
Ce n’est pas réellement une impasse mais plutôt une opportunité de rassembler les peuples autour de valeurs communes. Il y a d’abord un rôle essentiel que la société civile doit jouer. Surtout dans son positionnement de médiateur entre les acteurs locaux et les acteurs gouvernementaux, surtout transnationaux. Pour les ONGs, par exemple, qui sont représentées dans l’ensemble de ces pays, je pense qu’elles ont là l’ouverture pour être des médiateurs de paix qui rassurent les peuples. Aussi, elles pourront trouver des solutions empiriques au sujet ou au problème que la sortie de ces trois États pourrait entraîner. Que cela soit en termes de liberté de déplacement, d’échanges économiques, de coopération pour la sécurité et en termes de restauration des États de droit également.
Pour moi, la jeunesse ne doit pas agir de manière partisane en condamnant tant la Cedeao que l’Aes. Mais elle doit constituer un poids dans les négociations pour la restauration de la démocratie et des valeurs démocratiques des institutions.
Sachant que l’instabilité politique contribue à l’expansion du phénomène terroriste, doit-on craindre l’émergence de groupes armés non conventionnels aux abords des pays du Golfe de Guinée ?
Je pense que c’est une menace à ne pas prendre à la légère, au regard du passif en termes de violence en Côte d’Ivoire. La première attaque date de 2016, par exemple. Elle a eu lieu à Grand-Bassam, totalement au sud, près de la frontière avec le Ghana. Le reste des attaques et des incursions a eu lieu dans le nord. Mais aujourd’hui l’état des lieux dans les pays limitrophes et la nature des relations que ces derniers peuvent générer d’autres impacts. Notamment avec les pays de l’Aes, qui sont des pays frontaliers, font que l’on peut craindre l’émergence d’un tel phénomène.
Il faut analyser aussi, le prisme des revendications sociales, les questions de cherté de la vie, de l’intégration des migrants, les questions d’état civil sont également importantes dans nos différents pays. On peut craindre, et si l’on craint, cela veut dire que l’on peut anticiper. On doit d’ailleurs anticiper.
La Côte d’Ivoire, en raison de sa proximité avec le Mali et le Burkina Faso, est gravement exposée à l’extrémisme violent. Qu’est-ce qui expliquerait, selon vous, sa distinction dans la gestion de la lutte contre le terrorisme au regard des autres pays ?
L’avantage de la Côte d’Ivoire, à l’image même d’autres pays du Golfe de Guinée, aurait pu être qu’ils ont pu suivre l’expansion du phénomène extrémiste dans les pays limitrophes. Si bien que des mesures ont été prises par l’État de Côte d’Ivoire. Au nombre de celles-ci figurent des mesures sécuritaires couplées à des actions sociales. Avec des programmes sociaux du gouvernement, ce sont des emplois. Des habitations, des centres d’accueil de migrants qui ont été construits au niveau des zones nord du pays. En particulier à Doropo et Niellé.Aussi, il faut dire que ce sont des organisations de la société civile, des ONG nationales comme internationales qui sont déjà présentes sur le terrain pour baliser les événements.
Je pense également qu’il faut accentuer ces mesures dans toutes les autres zones frontalières au regard du passif de violence en Côte d’Ivoire. On sait que la zone de l’Ouest lors des événements politiques passés a été une des zones les plus touchées. De ce fait, aujourd’hui on pourrait craindre qu’un quelconque mouvement puisse profiter de ces carences ou du sentiment de délaissement. Ou alors des tendances politiques afin d’endoctriner ou de créer des foyers de radicalisation.
Au niveau sécuritaire, ce sont aussi des dispositifs sécuritaires importants qui sont mis en place dans certaines localités telles que Téhini, Kafolo, Ouangolodougou, toujours pour être plus proches des frontières afin que les espaces soient viabilisés, sécurisés. Pour que les réserves naturelles soient contrôlées, parce qu’elles abritent parfois en leur sein des personnes de manière illégale. Il y a un ensemble de mesures qui sont déjà prises. Mais la confiance n’exclut pas le contrôle.
Selon vous, quelles sont les principales mesures anti-terroristes qui contribuent à la stabilité observée dans les régions du nord de la Côte d’Ivoire ?
Comme souligné plus haut, je pense qu’il y a des dispositifs sécuritaires qui sont mis en place dans différentes régions. Aujourd’hui, aucune région de la Côte d’Ivoire n’est exempte de vidéos de surveillance. Donc ça aide beaucoup à repérer. Il y a un quadrillage de la zone qui est fait. Et des actions menées régulièrement par le Conseil national de sécurité qui a été mis en place depuis un bon moment. Depuis la Covid, je crois, pour réguler la situation. De même, il y a la communication. L’État fait l’effort de ne pas alarmer les populations.
Après, il faudra, comme dans tout État, éviter que cela n’empiète sur le respect des droits de l’homme, la liberté d’expression des gens. Bien entendu. Il y a aussi un accent mis sur la formation et la recherche avec la mise en place de l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT) qui est présente à Jacqueville et qui a pour vocation de coordonner les actions de formation que ce soit du personnel militaire ou des populations civiles afin qu’elles soient alertées et mieux outillées sur comment se comporter en cas de crise.
Pensez-vous que la gestion du terrorisme par la Côte d’Ivoire pourrait servir de modèle, en particulier en ce qui concerne l’investissement dans des stratégies innovantes ?
Autant d’autres pays peuvent s’inspirer de la Côte d’Ivoire, nous aussi nous pouvons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Déjà, des forces et des faiblesses existent en matière de lutte contre le terrorisme dans les pays cités précédemment, comme les pays de l’Aes, du Sahel et du Maghreb, généralement. Et également s’imprégner de ce que les pays limitrophes comme le Bénin, le Sénégal, le Togo et le Nigéria font comme action pour renforcer leur sécurité. Je pense qu’au-delà de ça, il ne s’agit pas de créer un modèle sur le fonctionnement d’un État. Mais plutôt de créer une synergie entre ces États pour que les actions qui sont entreprises au Mali n’aient pas des répercussions négatives en Côte d’Ivoire. Mais qu’il y ait une suite logique afin que d’un pays à un autre on voie que le phénomène se réduit.
La Côte d’Ivoire fait-elle face à des défis spécifiques dans sa politique de résolution des conflits liés au terrorisme ?
Il y a un cadre normatif à mettre en place, qui existe déjà sous le nom de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Il est dans sa phase de relecture et de revue. Je pense que sa revue nous permettra d’amender certains points. Si possible, de renforcer la place de la composante civile dans ses actions. De plus, ensemble redéfinir la place de la Cedeao et de toutes autres entités intergouvernementales dans cette architecture de prévention de l’extrémisme et du terrorisme.
L’initiative d’Accra visait à mutualiser les efforts des États ouest-africains pour contrer l’expansion du terrorisme. Sept ans après son lancement, pourquoi cette initiative peine-t-elle à s’imposer ?
L’initiative en soi est très intéressante. Dans l’implémentation, elle demande une certaine synergie des personnes chargées de son opérationnalisation. Tout réside dans la volonté politique. Si d’un régime à l’autre on est face à des politiques qui prennent ce sujet à bras-le-corps, on aura vraiment une évolution. Il y a aussi la question du financement..Qui de mon point de vue est assez importante. Dans la mesure où l’initiative d’Accra doit pouvoir s’autosuffire afin de ne pas dépendre de l’aide extérieure. Elle doit être en mesure justement de réagir en temps et en heure face à différentes menaces. Dans cet élan de volonté politique, ça peut se faire.
Si dans chaque pays, au niveau national, il y a des représentations en charge de cela, pour travailler sur les entités qui représentent l’architecture de paix et qui seront en charge également de suivre la mise en œuvre des résolutions de l’initiative d’Accra, ce serait très bénéfique. Pas que pour la Côte d’Ivoire mais pour toute la zone ouest-africaine. Il faut aussi faire une place au dialogue profond sur la forme de gouvernance de direction ou sur les orientations à donner à nos communautés économiques, notamment la Cedeao.
Si on veut une Cedeao des peuples, il faut écouter les peuples. Puis, savoir jouer la carte de la diplomatie jusqu’au bout. Et être rigoureux aussi sur l’application des textes quand il le faut. Je pense que cela permettra réellement d’aider dans le sens de la construction de la paix. Je pense que le phénomène du terrorisme aujourd’hui est connu. Documenté et étudié dans le pays du Golfe de Guinée. Il faudra donc se baser sur l’ensemble de ces données pour avoir une bonne approche. Travailler l’échange de l’intelligentsia des différents pays, à la sécurisation des personnes et des pays. De même que de rétablir l’État de droit autant que faire se peut. Et pour finir, accroître un peu l’axe social que l’on donne à la réponse au terrorisme dans nos localités.
Croyez-vous que la coopération régionale soit une solution incontournable contre le phénomène terroriste en Afrique de l’Ouest ? Même lorsqu’on sait cette dernière n’est centrée que sur le tout répressif.
Je suis convaincu que la coopération régionale est un instrument indispensable pour la lutte contre le terrorisme. Toutefois, ce qu’il faut, c’est d’orienter cette coopération régionale pas seulement sur le tout répressif. Mais, comme la carotte et le bâton, qu’on récompense les bonnes expériences. Qu’il y ait des sanctions et des mesures claires et des interventions claires coordonnées entre les États. De plus, que la société civile soit la plus impliquée dans la prévention, la gestion et les résolutions. Il doit en être de même en ce qui concerne le suivi post-crise. Enfin, qu’il y ait surtout de la redevabilité dans tout ce qui y est fait. Parce que les populations s’alarment parfois. Juste parce qu’elles n’ont pas l’impression de voir, de comprendre, de saisir ce qui se fait. Si on parvient à se lancer dans cette dynamique, je crois qu’on aura résolu une partie du problème.
LIRE AUSSI :
- Lakurawa : Menace à la jonction Bénin-Niger-Nigéria
- Erwan Florian Kouame : « La gestion du terrorisme en Côte d’Ivoire pourrait servir de modèle »
- Namidja Touré : « La militarisation des zones nord de la Côte d’Ivoire a ramené la stabilité »
- Démocratie et terrorisme: Face au procès, démêler l’écheveau