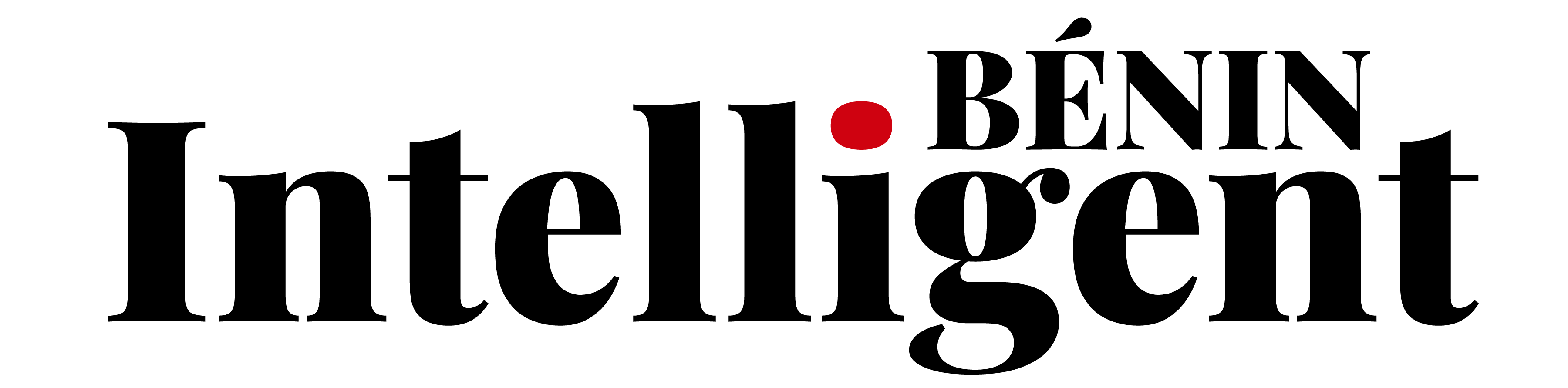Pour la société comme pour l’Église, les efforts des hommes les plus laborieux doivent être honorés et reconnus, surtout même ante mortem comme célébration des dons de Dieu à son peuple. Mais ordinairement, culturellement et même ecclésialement, nos reconnaissances sont souvent post mortem ou confinées aux titres et aux fonctions, ce qui ne manque pas d’attiser la quête du pouvoir… La dignité épiscopale a heureusement favorisé quelque hommage, de son vivant, à Mgr Barthélemy Adoukonou, témoin de la rencontre entre foi et culture et initiateur du mouvement d’inculturation Mewihwendo.
Un témoin de l’intelligence théologique béninoise
Mgr Barthélemy Adoukonou, grand homme de culture, et d’autres éminentes figures comme les Pères Jacob Agossou, Alphonse Quenum, de vénérées mémoires, et le Père Éfoé-Julien Pénoukou, certainement sous le leadership éclairé de leurs aînés comme Mgr Robert Sastre et Mgr Isidore de Souza, constituent des repères pour notre dire chrétien et africain de Dieu. Ils ont tous « fait » (dans tous les sens du terme), avec tant d’autres brillants après eux, l’Institut théologique d’Abidjan (ISCR, ICAO, UCAO)… Ils ont inspiré et inspirent encore tant de fidèles chrétiens africains, soucieux de la rencontre féconde entre Foi et Culture. Leur passion pour l’Église en général et pour l’Église en Afrique en particulier ne leur a certes pas épargné la passion, moins de l’Église que de nos pesanteurs culturelles.
De cette Église en Afrique, ils ont voulu indiquer des jalons ou des propositions pour un christianisme africain au-delà des contingences historiques assumées comme l’esclavage. Tous ordonnés dans les années 60, marqués par le Renouveau du Concile, attentifs aux illusions et désillusions des indépendances comme des revendications culturelles d’authenticité, s’estimant les uns et les autres comme en sont capables les Béninois entre eux, ils ont travaillé avec art, compétence et dévouement, chacun de son côté, souvent dans le ministère exaltant de la formation, parfois en divers autres pôles de responsabilité, au niveau de l’Église locale en Afrique comme au niveau de l’ Église universelle pour Mgr Barthélemy Adoukonou. Leur labeur théologique, pétri d’amour de l’Église, doit être poursuivi. Et il nous faut même aller plus loin pour une synodalité de pensée. Mais à l’œuvre, nous ne sommes pas meilleurs à nos Pères. L’espérance est pourtant permise.
Initiateur du Mewihwendo, une approche d’inculturation
D’autres personnes plus avisées évoqueront mieux que moi la réalité du Mewihwendo, laborieux effort anthropologique et théologique pour découvrir et discerner les semences du Verbe, les pierres d’attente présentes en toute culture. Ce mouvement a réalisé un énorme travail qui mérite d’être salué, honoré, travaillé, étudié, et aussi perfectionné avec méthode et esprit critique. Selon quel paradigme alors ?
Le Mewihwendo restera un Gbetowhendo appelé à accueillir le Gbedotohwendo, à partir du lieu fondamental et fondateur qu’est l’incarnation (Jn 1, 14). Et jamais à partir des cultures, toujours relatives et limitées. Partir d’abord des cultures expose à des incompréhensions comme l’a manifesté Fiducia Supplicans tant dans sa réception que dans la réponse de l’épiscopat africain. Toute inculturation authentique ou toute véritable théologie ne peut se passer du creuset de l’Incarnation rédemptrice. Comme le répétait Alioune Diop qu’aimait citer Mgr Adoukonou, « la culture est de l’homme ». En partant de la révélation dont le sommet indépassable est l’Incarnation rédemptrice, la théologie ou l’inculturation échappe à toute autoréférentialité personnelle et culturelle, qui exacerbe même inconsciemment nos susceptibilités culturelles maladives.
Par ailleurs, l’éminent théologien Joseph Ratzinger, maître de Mgr Barthélemy Adoukonou –sous la direction de qui il défendait sa thèse de doctorat le 25 mars 1977 à l’Université de Ratisbonne– l’avait justement perçu en 1993 en recommandant que l’inculturation s’ouvre à l’interculturalité, comme il l’a plus tard souligné dans Africae munus, n° 38. Démarche dont l’élève a souligné plus d’une fois, en diverses conférences, la pertinence. Il reste que la méthode de l’interculturalité féconde davantage le Mewihwendo : ainsi sera mieux appréciée, purifiée et sauvegardée l’immense œuvre théologique du grand théologien béninois, africain.
Mgr Barthélemy Adoukonou laisse à notre Église, un héritage, non seulement à conserver mais également à faire fructifier par de nécessaires dépassements. Il aimait rappeler à la culture occidentale, face à ses dérives obvies, que « l’homme tout court est trop court ». De même, le Hwendo tout court est trop court. Le Mewihwendo tout court est trop court. Mais de l’incarnation (He1, 1), il devient à la fois particulier et universel. Mgr Barthélemy Adoukonou, par l’intercession de Marie Notre Dame de l’Incarnation, soit à présent accueilli par l’Esprit de l’Universel Concret, dans le Mahouhwendo !
Par Père Rodrigue Gbédjinou, théologie, directeur de l’École d’Initiation Théologique et Pastorale (Eitp)
LIRE AUSSI
- Un À-Dieu à Mgr Marcel Agboton : Sous le signe de la Communion, de la Participation et de la Mission
- Dieudonné Gnammakou : «L’Église Catholique a tiré profit de la traite négrière. Qu’elle commette la réparation qui se doit»